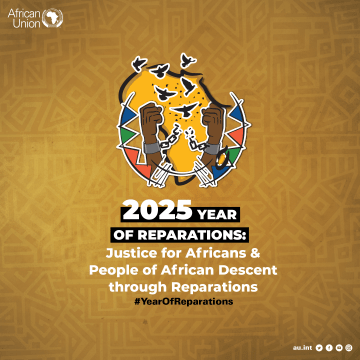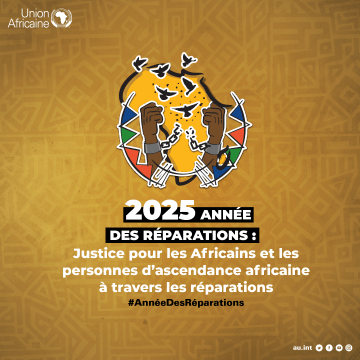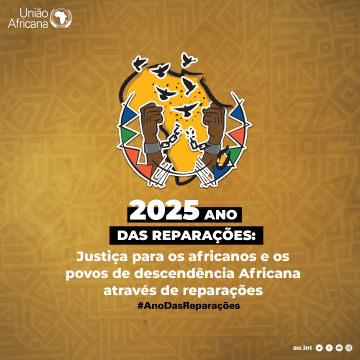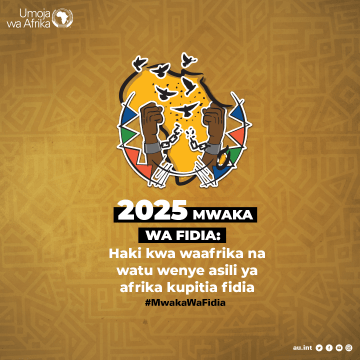Commission africaine des droits de l'homme et des peuples 85ème Session ordinaire
Banjul,
7 au 30 octobre 2025
Rapport d'activité intersessions
Présenté par l'Honorable Commissaire
Maria Teresa Manuela
Rapporteure Spéciale sur les Prisons, les conditions de détention et l'action policière en Afrique
Banjul, le 15 octobre 2025
Sommaire
I - INTRODUCTION 2
II - ACTIVITÉS RÉALISÉES PENDANT LA PÉRIODE INTERSESSION 2
A - En tant que Rapporteure Spéciale sur les Prisons, les conditions de détention et l’action policière en Afrique 2
B – En tant que membre d'autres Mécanismes 2
C - En tant que membre de la Commission africaine 2
D - En tant que Rapporteure pays pour le suivi 2
- Évolutions 2
III - ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'ÉTUDE SUR LES PRISONS EN AFRIQUE 2
A – Évolutions positives 2
B - Contraintes 2
IV - RECOMMANDATIONS 2
I. INTRODUCTION
SECTION I – INTRODUCTION
1. Le présent rapport est présenté conformément aux articles 25 (3), et 64 du Règlement intérieur 2020 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission), qui exigent que chaque mécanisme subsidiaire et chaque membre de la Commission présente, à chaque session ordinaire, un rapport écrit sur les activités menées entre deux sessions ordinaires.
2. Le rapport porte sur la situation des prisons, les conditions de détention et l'action policière en Afrique, conformément au mandat qui lui a été confié, à savoir examiner la situation des personnes privées de liberté ; examiner l'état des prisons et les conditions de détention en Afrique et formuler des recommandations en vue d'améliorations ; préconiser l'adhésion à la Charte et aux normes et standards internationaux relatifs aux droits de l'homme concernant les droits et les conditions des personnes privées de liberté ; examiner la législation et les réglementations nationales pertinentes dans les États parties respectifs, ainsi que leur mise en œuvre, et formuler les recommandations appropriées sur leur conformité avec la Charte et les autres lois et normes internationales.
3. D'autre part, en ce qui concerne la police, le Mécanisme doit mener des études sur les questions pertinentes liées à l'action policière et aux droits de l'homme en Afrique et identifier les meilleures pratiques à cet égard ; prendre des mesures pour garantir que les questions policières et les droits de l'homme soient pris en compte et reflétés dans le mandat de la Commission ; diffuser les Directives de la Commission sur les conditions de détention, la garde à vue et la détention provisoire en Afrique et d'autres instruments pertinents, encourager leur mise en œuvre par les États parties et collaborer avec les autres mécanismes spéciaux de la Commission sur les questions transversales liées à la police et aux droits de l'homme.
4. Ce mandat est directement fondé sur l'article 6 de la Charte, qui stipule que « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement fixés par la loi : en particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement . », mais également sur les articles 4 - « ... tout être humain a droit au respect de sa vie et de son intégrité physique... » ; 5 - « ... respect de la dignité inhérente à la personne humaine... » et 7 - « ... droit de recours devant les tribunaux pour tout acte violant les droits fondamentaux ; droit à la présomption d'innocence ; jugement dans un délai raisonnable ; condamné pour une infraction légalement punissable... ».
5. Ce rapport est donc présenté en ma qualité de membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission) ; Rapporteure Spéciale sur les prisons, les conditions de détention et l'action policière en Afrique (la Rapporteure spéciale) ; membre du Groupe de travail sur la peine de mort et membre du Groupe de travail sur les communications. Il inclura également les activités menées en tant que Rapporteure pour la mise en œuvre des droits de l'homme dans cinq (5) pays lusophones d'Afrique, à savoir : le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique et Sao Tomé-et-Principe.
6. Il couvre les activités menées entre la 81e et la 83e session ordinaire, soit du 1er octobre 2024 au 1er mai 2025, et est conforme aux objectifs fixés dans la matrice d'exécution du plan annuel, découlant du Plan stratégique 2021-2025.
7. Le rapport est divisé en cinq (5) parties : introduction ; activités menées ; situation des droits de l'homme dans les pays relevant de ma responsabilité ; évolution de l'étude sur les prisons et recommandations.
II. ACTIVITÉS RÉALISÉES PENDANT LA PÉRIODE INTERSESSION
8. Au cours de cette période, j'ai participé aux activités programmées par la Commission, par le Mécanisme, ainsi que par les Mécanismes dont je fais partie, et aux travaux programmés par les partenaires, mais qui présentent un intérêt pour la Commission africaine, car ils servent à renforcer la coopération et à diffuser le travail accompli par la Commission. Voici donc le résumé des activités menées :
A. EN TANT QUE MEMBRE DE LA COMMISSION AFRICAINE
(i) PARTICIPATION AUX SESSIONS STATUTAIRES
9. En tant que membre de la Commission africaine, j'ai participé à la 84e session de la Commission qui s'est tenue du 21 au 30 juillet, de manière virtuelle. Au cours de cette session, plusieurs questions ont été abordées, parmi lesquelles l'analyse et la prise de décisions sur les communications ; la révision des documents internes et l'adoption de nouveaux documents pour le bon fonctionnement de la Commission ; elle a également fait de même en ce qui concerne les observations sur les rapports des États présentés conformément à l'article 62 de la Charte africaine ; elle a examiné les rapports sur les études, les articles et le Plan stratégique pour la période 2026-2028 et, enfin et surtout, elle a adopté un nouveau format pour la Session suivante, compte tenu de la situation financière actuelle de la Commission. Le communiqué final peut être consulté sur le site web de la Commission.
10. Le 19 juin, j'ai participé à la 38e session extraordinaire au cours de laquelle ont été passées en revue les questions à discuter lors de la 85e session ordinaire, discutées des questions internes et, surtout, adopté le nouveau format des sessions. Le communiqué final peut être consulté sur le site web de la Commission.
11. Le même jour, j'ai participé à la réunion consultative entre le Conseil de paix et de sécurité (CPS) et la Commission, conformément à l'article 23 de la Charte africaine et à l'article 3, alinéa f) du Protocole du CPS, afin de renforcer la coordination institutionnelle et de promouvoir une approche fondée sur les droits pour la prévention et la réponse aux conflits. Les deux réunions se sont déroulées en ligne.
(ii) PARTICIPATION AUX MISSIONS DE PROMOTION
12. J'ai participé à la mission de promotion en République du Ghana qui s'est déroulée du 29 septembre au 3 octobre, dont la délégation était conduite par Mme la Vice-Présidente de la CADHP, l’Honorable Commissaire Janet Ramatouilie Sallah-Njie, et composée les Honorables Commissaires Solomon Ayele Derso, Hatem Essaem et Mudford Z. Mwandenga. Précédée de plusieurs autres activités, la mission s'est déroulée selon le calendrier préétabli et a donné des résultats positifs.
13. Les interactions avec les organes gouvernementaux, les organes des Nations unies basés sur le terrain, la Commission nationale des droits de l'homme et de la justice administrative et la société civile ont permis de constater l'engagement de l'Ét e à garantir la mise en œuvre des droits de l'homme sur le territoire et les défis qui subsistent dans cette tâche.
14. Des visites ont été effectuées dans un centre pénitentiaire de sécurité moyenne et dans un centre d'accueil pour mineurs, qui ont besoin d'une protection sociale et qui sont en conflit avec la loi. De plus amples commentaires à ce sujet figureront dans la section appropriée.
(iii) LETTRE D'APPEL ET LETTRES DE PRÉOCCUPATION
15. En notre qualité de membre de la Commission et avec l’Honorable Commissaire Idrissa Sow, nous avons envoyé en octobre dernier une lettre de préoccupation à l'État mozambicain concernant des allégations de violations des droits humains à l'encontre de civils sur le territoire national. Nous attendons la réponse de l'État requis.
(iv) TRAVAIL AU SEIN DES AUTRES MÉCANISMES DE LA COMMISSION
16. Le 25 juin, j'ai participé à la réunion du groupe de travail sur les communications, présidée par l’Honorable Présidente et composée de M. le Commissaire Idrissa, au cours de laquelle ont été discutées des situations relatives à la réception administrative des communications ainsi que les résultats de l'audit narratif de l'état des communications.
17. Le 3 juillet, j'ai participé à la consultation organisée sur le projet d'étude révisé sur la peine de mort en Afrique. Son objectif général était de renforcer la capacité de la Commission à répondre aux questions liées à la peine de mort, contribuant ainsi à recueillir des avis pour améliorer l'étude susmentionnée et discuter des mesures concrètes à prendre pour la finaliser.
B. EN TANT QUE RAPPORTEURE SPECIALE SUR LES PRISONS, LES CONDITIONS DE DETENTION ET LES PRATIQUES POLICIERES EN AFRIQUE
18. Au cours de la 83e session, j'ai tenu plusieurs réunions de travail, bilatérales et certaines multilatérales, avec des partenaires du mécanisme. Au cours de ces réunions, plusieurs questions liées aux relations de coopération ont été examinées, ainsi que la mise à jour et le partage d'informations sur des sujets liés aux prisons, à la police et aux conditions de détention dans divers pays. Les partenaires naturels du mécanisme ont renouvelé leur volonté de poursuivre leur collaboration, tandis que les nouveaux partenaires, principalement ceux qui ont rejoint le mécanisme dans le cadre de l'étude en cours « », ont examiné les possibilités et les conditions d'une collaboration fructueuse.
C. EN TANT QUE RAPPORTEURE NATIONALE
19. Dans cette section, je présenterai un bref résumé du travail accompli dans le cadre de la supervision de la mise en œuvre des droits humains prévus dans la Charte africaine.
1. CAP-VERT
20. La situation des droits de l'homme au Cap-Vert est stable. La Commission n'a pas eu connaissance de cas dramatiques de violations des droits de l'homme. Le pays jouit d'une bonne réputation en matière de liberté d'expression et de bonne gouvernance, figurant parmi les pays les plus libres au monde , et son système démocratique a été capable de produire une alternative pacifique au pouvoir.
21. Cependant, certains problèmes liés à l'accès au pays pour les touristes ou les visiteurs africains ont été signalés. Malgré la réactivité des autorités pour expliquer les circonstances des incidents aux frontières avec les visiteurs africains, la persistance de ces incidents est préoccupante et nous encourageons les autorités capverdiennes à redoubler d'efforts pour résoudre ce problème.
22. En termes d'engagement auprès des institutions de l'Union africaine, le Cap-Vert fait toujours partie des pays qui n'ont présenté qu'un seul rapport périodique (1987-1996), bien que le pays soit Etat partie à la Charte depuis le 6 août 1986, date à laquelle il a déposé son instrument de ratification de la Charte. Le Cap-Vert n'a pas signé le protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce qui limite le niveau de protection des droits de l'homme dans le pays.
23. Il est toutefois regrettable de constater que le gouvernement du Cap-Vert a dû déclarer l'état de catastrophe dans les municipalités de S. Vicente (île de S. Vicente) ; Porto Novo (île de S. Antão) ; Ribeira Brava et Tarrafal de S. Nicolau (île de S. Nicolau), en raison des dégâts causés par la vague tropicale qui a frappé les îles de Santo Antão et S. Nicolau, à l'aube du 11 août dernier.
24. On estime que cet événement naturel aura un impact sur la sécurité alimentaire du pays. On pense que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour minimiser les souffrances des personnes touchées.
2. GUINÉE-BISSAU
25. Au cours de la période considérée, nous avons constaté avec satisfaction que le pays poursuit le processus de présentation de son premier rapport périodique à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. À cette fin, il a entamé le processus d'élaboration du rapport périodique combiné, couvrant toute la période depuis le dépôt de son instrument de ratification de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte) le 6 mars 1986. Le rapport combiné devrait être déposé et examiné l'année prochaine.
26. Il convient également de noter qu'après une certaine période d'incertitude, nous constatons avec satisfaction que les élections générales (présidentielles et législatives) auront lieu le 23 novembre de cette année.
27. La Guinée-Bissau reste l'un des rares pays à avoir ratifié le protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et à avoir déposé la déclaration permettant aux particuliers et aux organisations non gouvernementales d'accéder directement à notre plus haute instance judiciaire en matière de droits de l'homme. Cette mesure constitue une étape importante dans la valorisation des institutions africaines et l'expression de la confiance qui leur est accordée pour résoudre les problèmes africains.
28. Nous saluons également l'ouverture de la Guinée-Bissau à l'octroi de la nationalité guinéenne aux personnes d'ascendance africaine, ce qui constitue une étape importante dans la reconstitution de l'histoire de l'Afrique et la correction des moments historiques les plus sombres. À cet égard, une lettre d'appréciation a été envoyée en temps opportun aux autorités du pays.
29. Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Guinée-Bissau a connu des situations peu flatteuses dans le domaine des droits de l'homme.
30. On signale des cas d'usage excessif de la force par les forces de sécurité, de restriction ou de limitation de l'exercice du droit de manifestation et de la liberté d'expression, d'enlèvements ou de disparitions forcées perpétrés contre des défenseurs des droits de l'homme et des opposants, le cas le plus récent étant l' t le passage à tabac de l'ancien président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme. Il est donc recommandé qu'une enquête indépendante et impartiale soit ouverte dans le pays afin d'identifier les auteurs de cet acte criminel et de les traduire en justice.
31. Bien que le pays ait toujours organisé des élections dans des conditions pacifiques, certains rapports font état d'inquiétudes concernant les élections générales prévues le 23 novembre prochain. Nous pensons que les auteurs prendront les mesures nécessaires pour créer les conditions requises afin que les élections se déroulent conformément à la législation nationale et aux normes internationales en la matière.
3. GUINÉE ÉQUATORIALE
32. La Guinée équatoriale a connu des améliorations notables dans le domaine économique, en particulier en matière d'accès à l'éducation de base et aux soins de santé dans les zones urbaines, ce qui a permis d'améliorer le taux d'alphabétisation, en particulier chez les jeunes.
33. Le pays a également enregistré une certaine évolution dans la présence des femmes dans la fonction publique et la magistrature, même si la question de l'égalité des sexes reste un défi majeur.
34. Cependant, le pays reste confronté à des défis majeurs en matière de droits humains, en particulier dans le domaine des libertés politiques, notamment l'exercice du droit à la liberté d'expression et de manifestation.
35. L'accès à l'information sur la situation des droits de l'homme dans le pays reste généralement critique ; l'espace civique reste restreint et la société civile est embryonnaire.
36. En termes d'engagement auprès des institutions de l'Union africaine des droits de l’homme, le pays affiche une faible collaboration, faisant même partie des pays qui n'ont jamais présenté les rapports périodiques prévus à l'article 62 de la Charte africaine, bien qu'il l'ait ratifiée en août 1986.
37. De même, la Guinée équatoriale a signé le protocole qui a créé le Protocole sur la création de la Cour africaine en 1998, mais ne l'a pas ratifié. Cette situation limite le niveau de protection des droits humains sur le territoire.
4. MOZAMBIQUE
38. La situation des droits de l'homme au Mozambique a été essentiellement marquée par des questions de sécurité, en raison du terrorisme qui sévit dans le pays et de la crise postélectorale de cette année qui a encore des répercussions sur la sécurité, l'intégrité physique et les libertés fondamentales des personnes, en particulier dans l'exercice de la liberté d'expression et du droit de manifester.
39. Récemment, la Commission a reçu des informations faisant état d'enlèvements, de disparitions forcées, d'assassinats et de tentatives d'homicide, y compris contre des agents de sécurité et des forces de l'ordre. Les populations de certaines régions du pays, notamment à Mocímboa da Praia, ont des difficultés à retourner dans leurs zones d'origine. Cette dernière situation a justifié l'envoi d'une lettre d'inquiétude au gouvernement du Mozambique.
40. En termes d'engagement avec les institutions de l'Union africaine, le Mozambique a un bon bilan de collaboration, dont le dernier rapport couvre la période 2015-2021. Le Mozambique a ratifié le protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais n'a pas déposé la déclaration permettant l'accès direct aux particuliers et aux ONG, ce qui limite le niveau de protection des droits humains dans le pays.
5. SAINT-OMÉ-ET-PRINCIPE
41. La situation des droits de l'homme à Sao Tomé-et-Principe est stable. La Commission n'a pas eu connaissance de cas dramatiques de violations des droits de l'homme. Cependant, des problèmes liés au travail des enfants et à la violence sexiste persistent.
42. En termes d'engagement auprès des institutions de l'Union africaine, Sao Tomé-et-Principe fait toujours partie des pays qui n'ont pas présenté leur premier rapport périodique, bien que le pays soit partie à la Charte depuis le 28 juillet 1986, date à laquelle il a déposé son instrument de ratification de la Charte. -Tomé-et-Príncipe n'a pas signé le protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce qui limite le niveau de protection des droits de l'homme dans le pays.
43. Malgré le plaidoyer mené auprès des points focaux du pays, il est difficile d'adhérer aux initiatives. Celles-ci ont pourtant porté leurs fruits en Guinée-Bissau et au Cap-Vert.
44. Toutefois, les efforts se poursuivront afin de trouver une forme d'interaction avec la Commission qui convienne à l'État.
D. SITUATION DES PRISONS ET ÉTUDE SUR LES PRISONS ET LES CONDITIONS DE DÉTENTION
45. Dans ce rapport, j'aborderai certaines questions liées aux prisons dans les pays que j'ai visités et dans les pays dont j'ai obtenu des informations. Je donnerai ensuite quelques brèves informations sur l'état d'avancement de l'étude sur les prisons.
46. Au cours de la période considérée, à l'invitation de partenaires, je me suis rendue en Ouganda en août de cette année, accompagnée du juriste principal du Secrétariat qui assiste le Mécanisme, M. Pedro Rosa, et de l'expert chargé de l'étude sur les prisons, M. Tim Binsong, afin de participer à la Baraza (réunion régionale). Cette activité existe depuis plus de 10 ans dans ce pays et traite des questions liées aux litiges en matière de droits sexuels et reproductifs des femmes. Mais cette édition était axée sur les femmes incarcérées, principalement pour le crime d'avortement.
47. Elle a permis de réfléchir sur le crime d'avortement, sur les femmes incarcérées qui n'ont pas les moyens financiers d'obtenir une assistance judiciaire, sur les femmes analphabètes qui acceptent n'importe quelle décision, ignorant leur droit de recours, et sur le manque d'opportunités pour les femmes d'accéder à une santé reproductive humanisée.
48. J'ai profité de l'occasion pour parler du mécanisme et de la contribution que la CADHP peut apporter à l'amélioration de la législation nationale dans les pays où il existe des crimes qui pénalisent spécifiquement les femmes.
49. Dans ce pays, lors de mes contacts avec le ministre de la Justice, j'ai plaidé en faveur de la formation des organes de sécurité et d'ordre publics et du relèvement de l'âge minimum de la responsabilité pénale, qui est actuellement fixé à 12 ans.
50. J'ai également été en contact avec plusieurs partenaires qui travaillent sur ces questions et je les ai mobilisés pour qu'ils participent activement à l'étude en cours.
51. Du 16 au 18 septembre, à l'invitation de l'Institut Raoul Wallenberg, j'ai co-organisé un atelier de haut niveau des chefs des services correctionnels/pénitentiaires et participé à la 7e conférence de l'Association africaine des services correctionnels (ACSA).
52. Cette conférence avait pour thème « La mise en œuvre des résolutions de la CADHP », un sujet très pertinent qui a permis d'aborder l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les organismes de protection des droits de l'homme sur le continent. Douze pays africains, principalement anglophones, étaient représentés.
53. Lors de cet événement, j'ai participé aux tables rondes d'ouverture et de clôture, présidées par le secrétaire principal du département d'État des services correctionnels, la secrétaire du cabinet du ministère de l'Intérieur et de l'Administration nationale, ainsi que le commissaire général des prisons du Kenya.
54. L'intervention de la Commission lors de l'événement s'est articulée autour de plusieurs axes et a été présentée par les membres de la délégation du Mécanisme :
Présentation sommaire du Mécanisme du Rapporteur spécial sur les prisons, les conditions de détention et le maintien de l'ordre en Afrique
Directives, principes et résolutions adoptés dans le cadre du Mécanisme
Mécanismes de suivi de la mise en œuvre
Le rôle des États parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : les services correctionnels/pénitentiaires
Le rôle de la société civile
Défis.
55. Quelques conclusions finales et recommandations visant à améliorer les relations ont été présentées.
56. Comme on peut le constater, l'interaction s'est concentrée sur les prisons, la coopération entre les différents services pénitentiaires, la formation du personnel pénitentiaire et la réinsertion des détenus, l'octroi de la liberté conditionnelle, les peines alternatives à l'emprisonnement effectif, la coopération avec d'autres entités dans divers domaines afin de répondre à certains besoins des prisons, entre autres aspects importants. Un environnement propice à la coopération a été créé et certains pays, comme le Zimbabwe, ont accepté notre offre de formation du personnel pénitentiaire. D'autres ont pris le temps de réfléchir à la proposition.
57. Ici, l'absence de représentants des services pénitentiaires des pays africains de langue officielle portugaise (PALOP) a été mentionnée, ce qui entraîne une différenciation dans les approches continentales.
58. Au cours de l'événement, les participants ont visité la prison de haute sécurité de Kamiti, où nous avons eu l'occasion de respecter une tradition de cet établissement pénitentiaire consistant à planter des arbres pour symboliser la relation de coopération avec les visiteurs. Je l'ai fait en ma qualité de commissaire auprès de la Commission africaine.
59. Dans cet établissement pénitentiaire, nous avons pu découvrir les conditions d'hébergement, d'alimentation et surtout de formation professionnelle des détenus. À cet égard, nous avons pu visiter une usine de couture industrielle qui produit des uniformes pour les détenus, les gardiens de prison, les écoles et d'autres entités qui font appel à ses services. C'est un bon exemple à reproduire.
60. En raison du niveau de sécurité élevé et du caractère imprévu de la visite, il n'a pas été possible d'interagir avec les détenus. Cependant, nous avons constaté certaines lacunes dans la conception des installations, compte tenu du respect des droits humains des détenus. Au moment opportun, nous avons contacté les responsables pour leur faire part de ces petits détails.
61. Lors de la visite promotionnelle en République du Ghana, il a été possible de visiter la prison de sécurité moyenne de Nsawam, où une visite bien programmée a été effectuée, mais affectée par le manque de temps.
62. Il y a des points positifs à souligner, que je mentionne ci-dessous :
63. Il a été possible de constater les succès de son programme d'enseignement dans le système pénitentiaire, où des enseignants affectés au ministère de l'Éducation, donc au système éducatif national, enseignent les matières figurant dans le programme national d'enseignement, à différents niveaux. Ceux-ci ne disposent toutefois pas d'une formation spécifique pour s'occuper des détenus.
64. Nous avons constaté l'existence de laboratoires d'informatique et de chimie qui fonctionnent au profit des étudiants détenus. Des diplômes ont déjà été décernés à des prisonniers qui ont suivi des études dans cet établissement.
65. Un autre aspect positif a été constaté dans le domaine de la santé, notamment le laboratoire d'analyses cliniques qui permet de diagnostiquer les maladies et ainsi de mieux soigner les détenus.
66. Toujours dans le domaine pénitentiaire, il convient de mentionner le travail accompli par la République du Cameroun en matière d'enseignement dans les établissements pénitentiaires, qui a permis à un certain nombre de détenus de se présenter à l'examen national d'accès à l'enseignement supérieur.
67. Il a été possible de rester en contact avec le médecin et le responsable du laboratoire et de confirmer qu'ils connaissent et maîtrisent les approches pénitentiaires fondées sur les droits humains.
68. Cependant, certains défis ont été constatés, notamment en ce qui concerne la surpopulation carcérale, qui est plus de 360 fois supérieure à la capacité physique installée. La cuisine, l'adoption tardive de la loi sur les peines alternatives à l'emprisonnement et d'autres aspects d'intérêt seront abordés dans un rapport avec l'État partie.
E. ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'ÉTUDE SUR LES PRISONS
69. Au cours de la session extraordinaire, une prolongation du délai pour la conclusion de l'étude a été demandée et les raisons fondamentales ont été exposées. Le délai demandé a été accordé par la résolution 636 (LXXXIII) 2025, adoptée en mai dernier.
70. Dans ce contexte, il convient de souligner les progrès notables réalisés dans l'alignement sur les principaux objectifs et délais fixés. Un bref rapport à ce sujet est donc joint en annexe.
F. CONTRAINTES
71. Comme dans toute activité, la question financière constitue un obstacle majeur à la poursuite de l'étude et les démarches en cours n'ont pas encore abouti.
72. Une autre contrainte importante est l'absence d'un juriste directement responsable de cette activité, chargé de collecter et de distribuer les données aux parties intéressées. Des efforts sont déployés pour adjoindre un autre juriste à M. Pedro, afin de mieux répondre aux activités du Mécanisme, étant donné qu'il coordonne d'autres dossiers importants au sein du Secrétariat.
III. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
A. CONCERNANT LES PRISONS
73. Ces recommandations sont réitérées, car elles ont été formulées dans le dernier rapport. Ainsi, réitérer les recommandations du dernier rapport présenté, en raison de certains développements positifs. Il convient donc de continuer à :
i. Encourager les États parties à participer activement, en collaborant et en autorisant les partenaires dûment accrédités à travailler à la collecte de données, pour le succès de l'étude ;
ii. Appeler les États parties à autoriser les visites du Mécanisme afin de permettre un contact direct avec les situations et un dialogue constructif, afin de permettre l'essai de réponses plus compatibles avec chaque situation dans les prisons ;
iii. Œuvrer au partage des bonnes pratiques en matière de gestion des prisons à l'échelle du continent, en mettant en œuvre la Déclaration d'Arusha de 1999 ;
iv. Élargir le réseau de coopération, en permettant à d'autres organes de l'État, principalement ceux qui font partie du système judiciaire, aux INDH, aux entreprises, aux universités et aux ONG, de participer d'une manière ou d'une autre à la résolution des défis de l'administration pénitentiaire ;
v. Appeler les États parties à recourir aux peines alternatives à l'emprisonnement, prévues dans certains cas par leur législation nationale, afin de réduire la surpopulation carcérale, quasi endémique, dans les établissements pénitentiaires ;
vi. Appeler les INDH et la société civile qui travaillent sur des questions liées aux prisons à participer efficacement à l'étude qui vient d'être lancée, afin qu'elle puisse être menée à bien avec succès ;
vii. Encourager les partenaires qui organisent les séminaires sur les infrastructures pénitentiaires à envisager la possibilité de les étendre aux pays lusophones, afin que tous les pays africains aient le même niveau de maîtrise des connaissances sur ces questions.
B. CONCERNANT LA POLICE
74. Sur ce point, je réitère également les recommandations figurant dans le dernier rapport, mais en mettant particulièrement l'accent sur :
i. Appeler les États à autoriser la mise en place de formations sur les instruments adoptés par la Commission et, là où elles existent déjà, leur mise à jour, dans le but de rapprocher l'action des forces de l'ordre et de la sécurité , dans l'équilibre entre « le respect et la protection des droits de l'homme et la garantie de la sécurité et de la tranquillité publiques ».
ii. Encourager les États à envisager la création d'un organe de contrôle externe des forces de l'ordre et de sécurité publiques, permettant ainsi le signalement et l'enquête indépendante sur les allégations d'abus de pouvoir et
iii. Appeler les partenaires du Mécanisme à continuer de fournir le soutien technique nécessaire afin de maintenir la publication et la distribution régulières du bulletin d'information « Police et droits de l'homme ».
C. AUX PAYS SUIVANTS
75. Compte tenu des situations mentionnées ci-dessus, dans ce point, nous remercions les cinq (5) pays chargés de surveiller la mise en œuvre des droits de l'homme pour leur engagement et recommandons ce qui suit :
i. Féliciter l'entrée de la Commission nationale des droits de l'homme et de la citoyenneté en tant que membre affilié de la Commission, scellant ainsi de manière positive tous les efforts déployés pendant de nombreuses années ;
ii. Encourager les gouvernements de la République du Cap-Vert, de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et de la République de Guinée-Bissau à poursuivre leurs efforts pour s'acquitter de leurs obligations en vertu de l'article 62 de la Charte africaine, de l'article 26 du Protocole de Maputo et de l'article 14 de la Convention de Kampala ;
iii. Les encourager également à faire les efforts nécessaires pour marquer leur présence aux sessions de la Commission africaine et à présenter leur candidature pour accueillir une session de la Commission dans leur pays respectif ;
iv. Encourager la République du Mozambique à poursuivre son intention d'accueillir une session de la Commission africaine, d'autoriser une mission de promotion et d'autoriser la formation des agents chargés de l'application de la loi sur les instruments produits par la CADHP sur ces questions ; et
v. Inviter la République de Guinée équatoriale à reprendre sa présence aux sessions de la Commission, ainsi que son interaction avec la Commission, et à prendre les mesures nécessaires pour élaborer et présenter son rapport d'État sur la mise en œuvre des droits de l'homme inscrits dans la Charte africaine - art. 62.
IV. CONCLUSION
76. En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui s'efforcent de faire de ce mécanisme un succès.
i. Je tiens tout particulièrement à souligner le soutien que j'ai reçu de certains États parties à la Charte africaine pour poursuivre cette mission difficile, car si les droits de l'homme constituent déjà un dilemme, les droits humains des prisonniers, invisibles parce qu'ils se trouvent derrière des murs, sont encore plus délicats à aborder. Mais il faut du courage pour lever le voile et parler de ce qui se passe réellement dans les prisons et les lieux de détention.
ii. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers les partenaires qui m'accompagnent dans cette démarche, qu'il est inutile d'énumérer car notre travail est vaste et remonte à très loin ; j'espère que nous resterons fermes dans notre objectif : faire des prisons un lieu où les droits humains peuvent être promus et respectés, tant pour les prisonniers que pour les agents qui y travaillent, en changeant le paradigme de leur compréhension.
iii. Je tiens à exprimer ma gratitude aux nouveaux partenaires du Mécanisme, à l'occasion de l'étude sur les prisons et les conditions de détention, en espérant que cela marque le début d'une relation de travail fructueuse avec la Commission africaine. J'encourage tout le monde à relever ce défi titanesque, car il est nécessaire de donner la parole à ceux qui sont incarcérés.
iv. Tous ensemble, États parties, INDH et autres institutions, y compris les institutions universitaires, religieuses, les ONG et autres partenaires, nous allons travailler à la mise en place de formations physiques afin de diffuser les publications de la Commission sur le respect des droits de l'homme, en particulier celles liées à ce Mécanisme.
Luanda, le 15 octobre 2025.
Maria Teresa Manuela
Commissaire