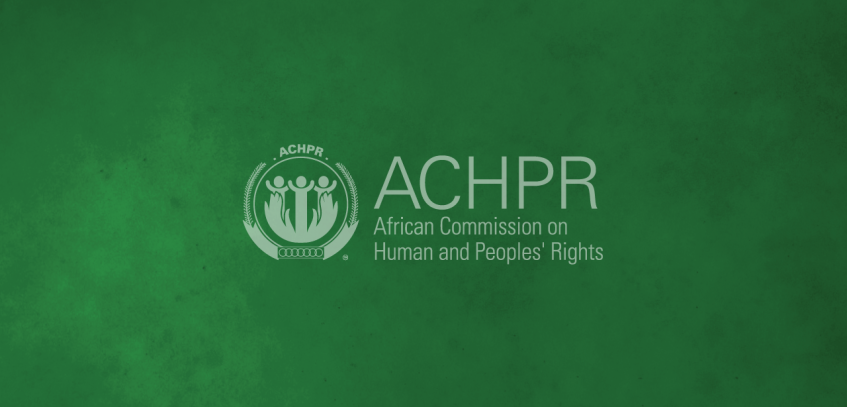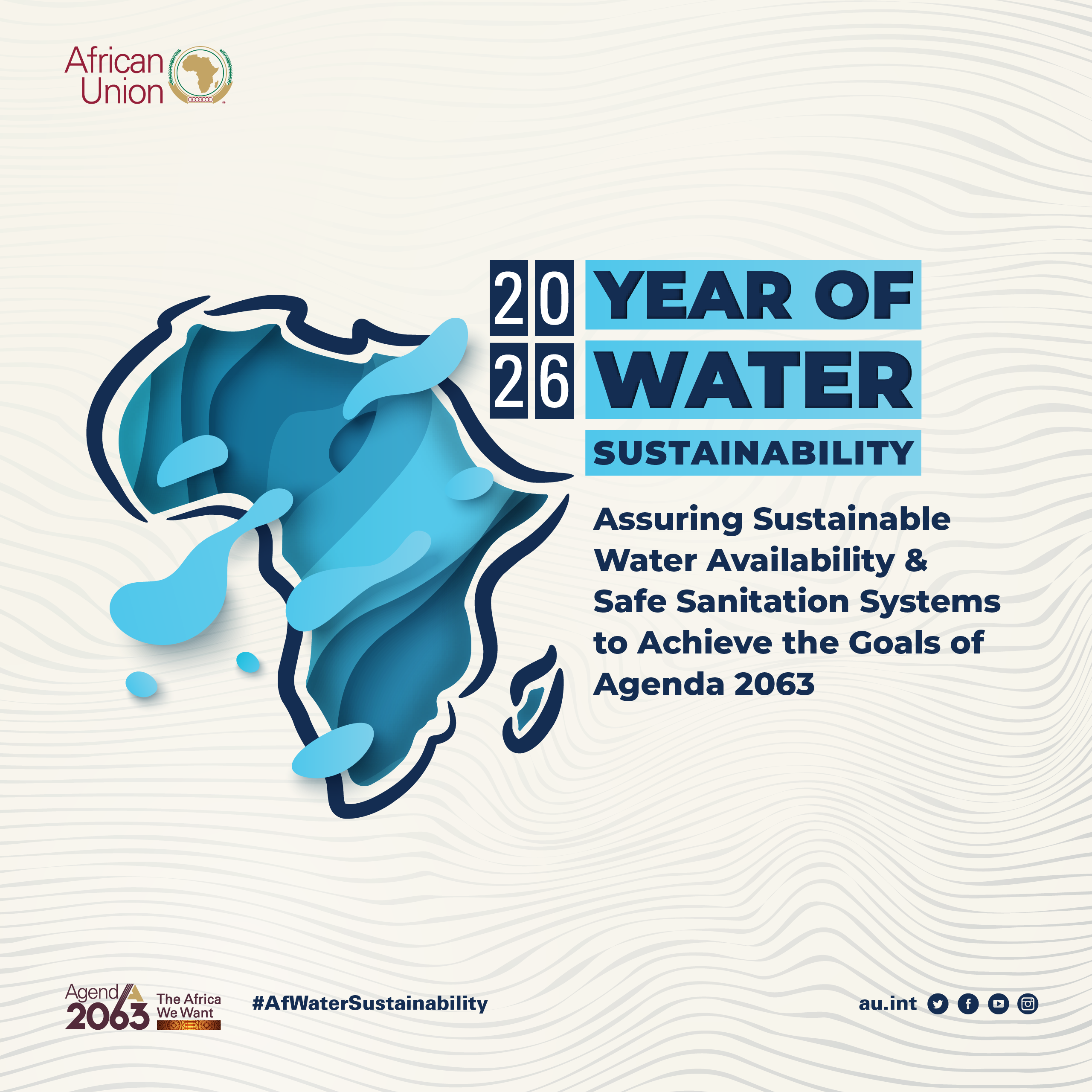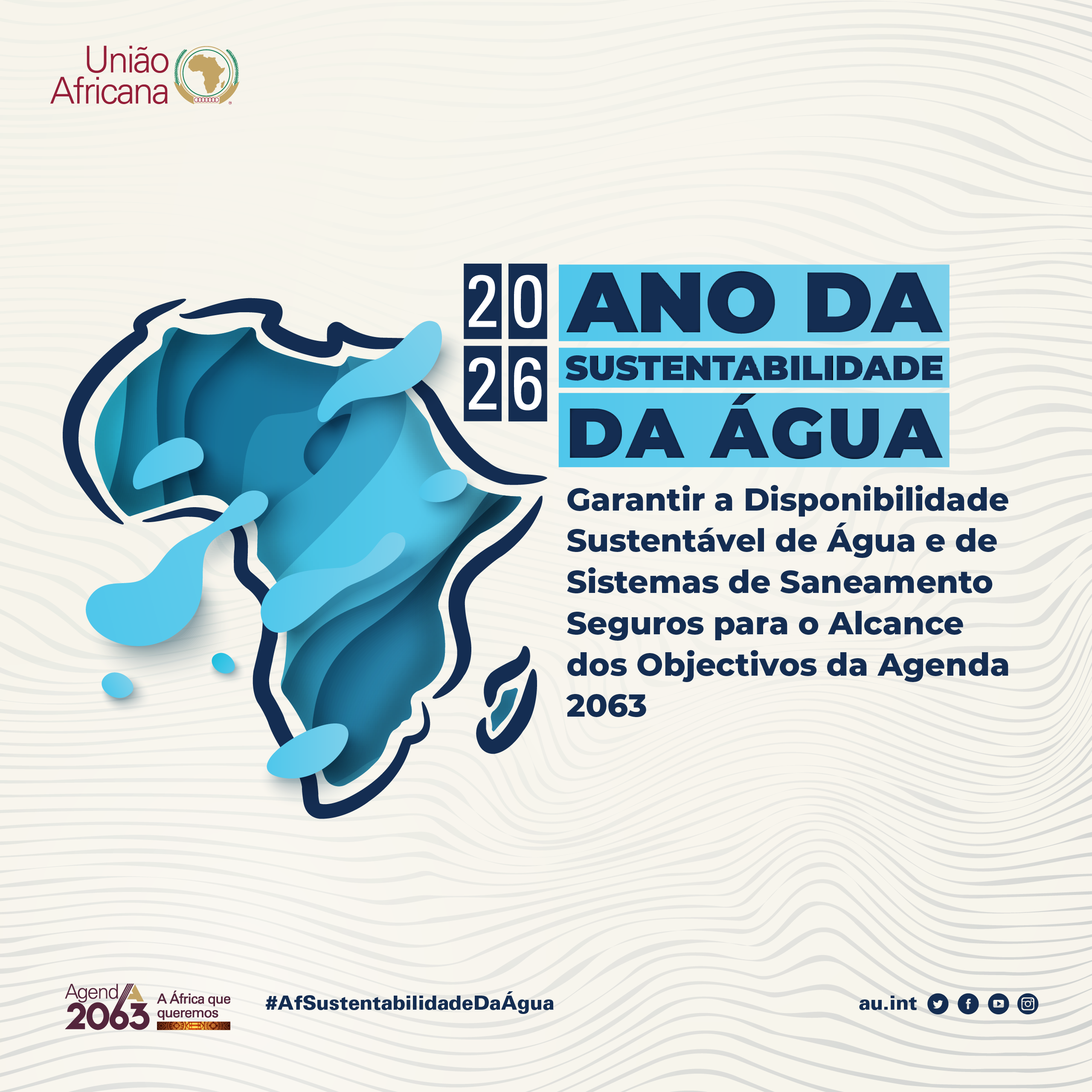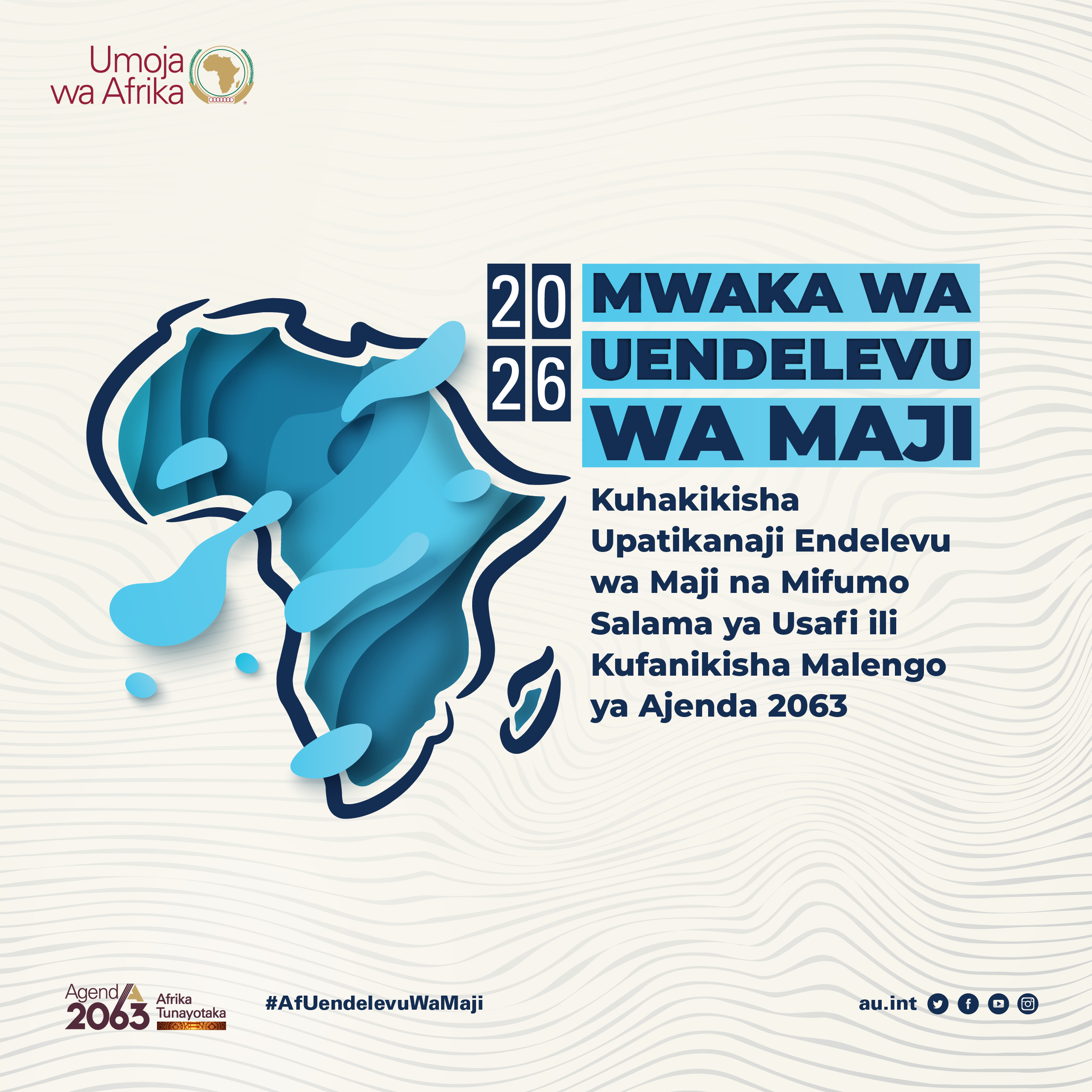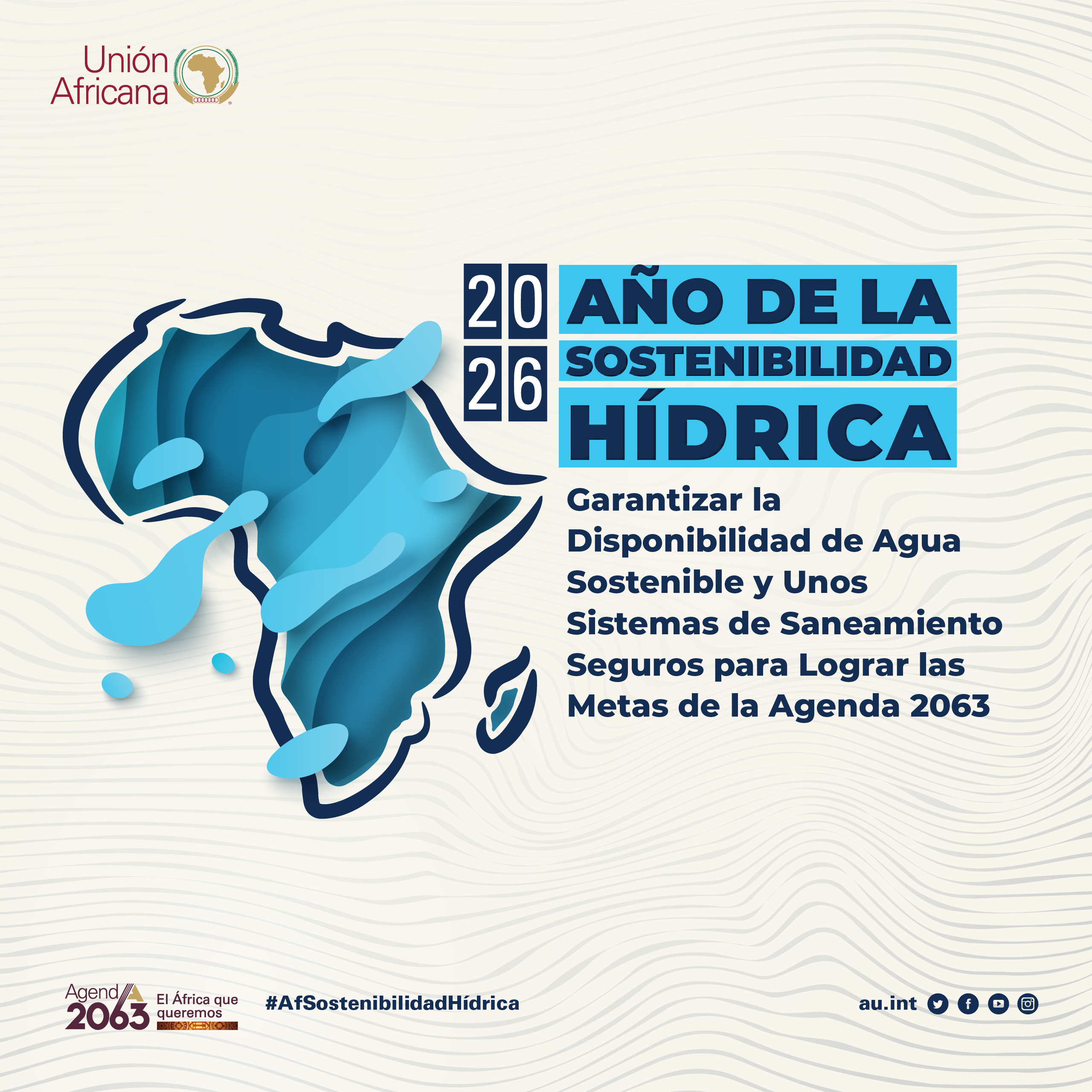La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, commémorée chaque année le 2 novembre.
En décembre 2013, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Résolution A/RES/68/163 sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, en tenant dûment compte du fait que le travail des journalistes les expose souvent à des risques d’intimidation, de harcèlement et de violence. En proclamant le 2 novembre Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, l’Assemblée générale condamne sans équivoque toutes les agressions et violences contre les journalistes et les professionnels des médias et décide de promouvoir un environnement sûr et favorable pour permettre aux journalistes d'exercer leur métier en toute indépendance et sans ingérence injustifiée.
Les journalistes jouent un rôle fondamental dans la société, en particulier en ce qui concerne la liberté d’expression et la libre circulation de l’information. En réduisant les journalistes au silence l'on n'entrave pas seulement la circulation de l’information, mais l'on compromet également la capacité des citoyens à exercer leurs droits démocratiques. Ce rôle clé se reflète dans la Déclaration de principes sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique (la Déclaration), adoptée par la Commission pour préciser la portée de l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en reconnaissant « le rôle clé que jouent les médias et autres moyens de communication en veillant au plein respect de la liberté d’expression, en facilitant la libre circulation des informations et des idées, en aidant les populations à prendre des décisions éclairées et en facilitant et en renforçant la démocratie. » 1
En Afrique, les attaques contre les journalistes continuent d’augmenter et il est aussi constaté qu'elles sont de plus en plus commises en ligne, alors qu'auparavant elles étaient le plus souvent physiques. Les attaques numériques contre les journalistes se produisent sous un large éventail de formats qui évoluent constamment au fur et à mesure de l’émergence de nouvelles technologies. La hausse de la violence numérique a tendance à toucher les femmes de manière disproportionnée, les journalistes femmes étant les premières victimes de ce phénomène croissant. La réduction des femmes journalistes au silence est assimilable à une atteinte à la démocratie.
Les femmes dans les médias sont particulièrement exposées, étant les cibles d'attaques ciblées et disproportionnées dans les sphères numériques et physiques. 2 Selon le Centre international pour les journalistes, 73% des femmes journalistes interrogées ont été confrontées à la violence en ligne, 25 % des messages dont elles étaient destinataires véhiculant des menaces de violence physique et 18 % des menaces de violence sexuelle. 3
« Alors que le monde numérique devrait être un espace d’innovation et d’autonomisation, il est devenu un champ de bataille où les femmes font face au harcèlement, à l’intimidation et à la violence. » 4 [TRADUCTION] Malheureusement, la révolution numérique a tout à la fois exacerbé les formes existantes de violence basée sur le genre, telles que le harcèlement sexuel, la traque, le discours de haine, la désinformation, la diffamation et l'usurpation d’identité, et créé de nouvelles formes d’abus, comme le piratage, la désinformation populaire orchestrée, la violence par les images, comme la divulgation de données personnelles privées (doxxing), le cyberharcèlement et la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (grooming). 5 De plus, « les menaces basées sur l’IA, y compris la propagation de la désinformation genrée, la surveillance, les deepfakes et autres formes de harcèlement, se sont développées avec ce problème émergent, également connu sous le nom de violence basée sur le genre facilitée par la technologie (TFGBV), et deviennent de plus en plus répandues de manière alarmante, notamment avec l’essor de l’intelligence artificielle générative. » 6 [TRADUCTION]
En plus de constituer des violations de l’article 9 de la Charte africaine, qui garantit aux individus le droit de recevoir des informations, ainsi que le droit d’exprimer et de diffuser des informations, ces attaques contre les femmes sont sans aucun doute assimilables à des violations du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), qui définit la violence à l’égard des femmes comme incluant les actes causant un préjudice psychologique ou économique, ou des menaces de restrictions arbitraires ou de privation des libertés fondamentales. En outre, son article 3 garantit le droit à la dignité et invite les États à mettre en œuvre des mesures appropriées pour assurer la protection de chaque femme contre toutes les formes de violence notamment sexuelle et verbale.
Ces garanties sont renforcées par la Déclaration qui prévoit en son Principe 5, que « L’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit d’accès à l’information est protégé contre toute atteinte, qu’elle soit en ligne ou hors ligne, et les États interprètent et mettent en œuvre la protection de ces droits dans la présente Déclaration et, en conséquence, les autres normes internationales pertinentes. » De plus, le Principe 20(6) exige des États qu’ils « prennent des mesures spécifiques pour garantir la sécurité des femmes journalistes et professionnelles des médias en prenant en charge les préoccupations liées au genre, notamment les actes de violence sexuelle ou basée sur le genre, les intimidations et les harcèlements. »
Face à cette préoccupation naissante, la Commission a adopté la Résolution ACHPR/Res.522(LXXII)2022sur la Protection des femmes contre la violence numérique en Afrique 7 qui appelle les États à, entre autres, réviser ou adopter une législation visant à lutter contre toutes les formes de violence numérique, en plus d’élargir la définition de la violence basée sur le genre pour inclure la violence numérique contre les femmes, y compris le cyberharcèlement, la cybertraque, les discours de haine sexistes, parmi d’autres violations connexes.
La Commission a saisi l'occasion de la commémoration de la Journée internationale contre l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, cette année, pour condamner toutes les formes de violence à l’encontre des journalistes, qu’il s’agisse de menaces physiques, de meurtres, d’enlèvements, de prises d’otage, d’intimidations, de détentions arbitraires et de tortures, ainsi que de harcèlement tant en ligne qu’hors ligne. En outre, compte tenu des préoccupations urgentes qui ont émergé à l’ère du numérique et qui touchent de manière disproportionnée les femmes journalistes, la Commission condamne sans réserve cette forme de violence et invite les États à prendre des mesures concrètes, telles que l’adoption de lois et politiques sensibles à la dimension genre, afin de garantir un environnement favorable dans lequel toutes les femmes journalistes pourront travailler sans craindre une quelconque forme de harcèlement ou d’intimidation. En outre, ces violations, qui incluent des menaces d’agression sexuelle et de violence physique, l’utilisation d’un langage abusif, des messages privés harcelants, des menaces de nuire à leur réputation professionnelle ou personnelle, des cyber attaques, des fausses représentations au moyen d'images manipulées et des menaces financières devraient faire l’objet d’enquêtes systématiques dont les auteurs seraient poursuivis, les victimes bénéficiant de réparations, notamment sous forme d’assistance médicale et psychologique. Les campagnes de plaidoyer public au moyen desquelles les États peuvent sensibiliser sur la violence numérique et assurer la protection des droits des personnes touchées par ces violations sont tout aussi importantes.
Les agressions en ligne visant des femmes journalistes représentent l’une des menaces les plus préoccupantes pour la liberté de la presse et les processus démocratiques, car elles favorisent et encouragent l’impunité pour les crimes contre les journalistes. Lutter contre cette violence nécessite une approche croisée impliquant un large éventail de parties prenantes, notamment les États, les plateformes de médias sociaux, les associations de journalistes, les organisations de la société civile. Les entreprises technologiques, par le biais desquelles ces abus sont perpétrés, sont lentes à réagir quant il s'agit d'apporter un soutien à des journalistes pris pour cible, sans parler de mettre hors d’état de nuire les auteurs de ces attaques. La Commission reste déterminée à coopérer avec toutes les parties prenantes pour s’attaquer à ce problème ainsi qu’à toutes les formes de crimes contre les journalistes, afin d’assurer une véritable liberté des médias en Afrique. Mettre fin à l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes reste un défi des temps modernes. Il faut regretter que les menaces de violence et les attaques contre les journalistes ne fassent pas l’objet d’enquêtes appropriées. Cette impunité pousse les auteurs de ces crimes à s'enhardir, tout en ayant un effet inhibiteur sur les journalistes. Les États africains devraient donc condamner publiquement toutes les attaques contre des journalistes, qu’elles se produisent en ligne ou hors ligne, et enquêter rigoureusement sur ces incidents. Les autorités judiciaires devraient instruire ces affaires et diligenter les poursuites contre les auteurs de ces crimes. Les entreprises technologiques devraient intensifier leurs évaluations des risques induits par les menaces en ligne contre les journalistes et prendre des mesures décisives pour traiter ces violations de droits via leurs services. Les acteurs du monde des médias devraient mieux se mobiliser lorsque leurs collègues sont victimes de telles menaces et faire campagne pour la justice. La société civile devrait exiger que l’état de droit s’applique en ce qui concerne le droit des journalistes et, enfin, la société dans son ensemble devrait reconnaître que la sécurité des journalistes contribue à leur accès à une information fiable et crédible. Lorsque tous ces acteurs travaillent ensemble, alors la société tout entière reçoit pour message que de telles attaques contre les journalistes ne seront pas tolérées. Ces facteurs contribueront également à créer un environnement sûr et favorable pour que les journalistes puissent effectuer leur travail de manière indépendante et sans aucune interférence, une situation qui profitera à l'ensemble de la société. Les journalistes sont les pourvoyeurs d’informations crédibles qui contribuent à l'avènement d'une démocratie qui fonctionne. En mettant fin à l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, nous renforçons la circulation de l’information et consolidons la démocratie.
Banjul, 2 novembre 2025
Commissaire Ourveena Geereesha Topsy-Sonoo
Rapporteure spéciale sur la Liberté d’expression et l’Accès à l’information en Afrique
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
1. https://achpr.au.int/en/node/902
2. https://rfkhumanrights.org/report/gbv-against-women-journalists-in-east-and-west-africa/
3. https://jamlab.africa/countering-online-violence-against-women-journalists-done/
4. https://cipesa.org/2025/01/african-womens-digital-safety-from-resolution-to-reality/
5. https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women
6. https://www.un.org/en/observances/end-impunity-crimes-against-journalists
7. Adopted by the Commission during its 72nd Ordinary Session held virtually from 19 July to 02 August 2022