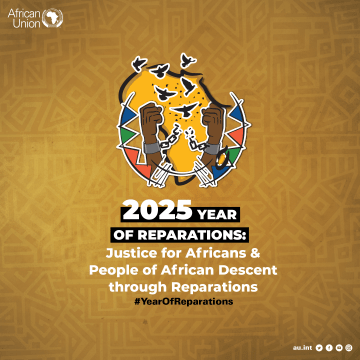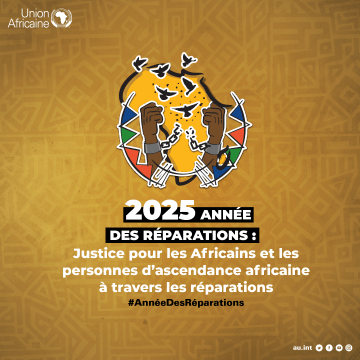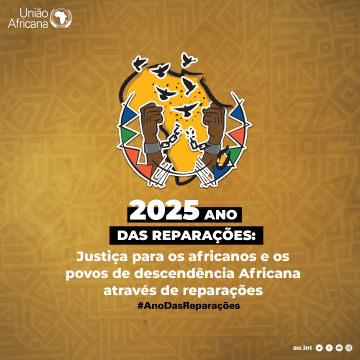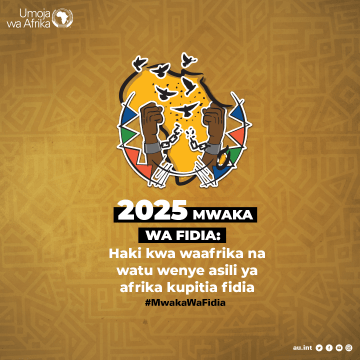85ème Session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
21 au 30 Octobre 2025
RAPPORT D’INTERSESSION
Par
Mme Selma SASSI-SAFER
Commissaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
&
Rapporteure Spéciale sur les Réfugiés, les Demandeurs d’asile, les Personnes Déplacées et les Migrants en Afrique
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport rend compte, au titre des Règles 25 (3) et 64 du Règlement intérieur (2020) de la Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission), des activités de promotion et de protection des droits de l’homme entreprises au cours de la période d’intersession, depuis la 83eme Session ordinaire de la Commission tenue du 2 au 22 mai 2025 à Banjul, Gambie.
2. Le rapport comprend les activités menées en ma qualité de Commissaire, membre de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, y compris les activités menées en vertu du mandat qui m’a été confié en ma qualité de Rapporteure Spéciale sur les Réfugiés, les Demandeurs d’asile, les Personnes Déplacées internes et les Migrants en Afrique en vertu de la Résolution- ACHPR/Res.577 (LXXVII) 2023 sur la nomination du Rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique .
3. Il fait également l’état des lieux de la ratification de la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées internes (Convention de Kampala), ainsi que l’état du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les aspects spécifiques du droit à la nationalité et l’éradication de l’apatridie en Afrique.
4. Il contient une analyse de la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile, des personnes déplacées internes et des migrants sur l’ensemble du continent ainsi que de la situation des droits de l’homme dans les pays dont j’ai la charge, à savoir la Libye, le Niger, le Sénégal et la Tunisie, et enfin il se clôture par des recommandations formulées à l’endroit des différentes parties prenantes.
II. ACTIVITES DU MECANISME SPECIAL
A. ACTIVITES DE PROTECTION
5. Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de protection et de promotion qui m’est dévolu en tant que Rapporteure pays et Rapporteure Spéciale sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées internes et les migrants en Afrique, j’ai mené les actions suivantes :
1) Appels Urgents
• Lettre d’appel urgent conjoint sur la dissolution des syndicats du secteur de la justice et la radiation de deux magistrats dirigeants du Syndicat Autonome des Magistrats au Niger. (Niger,23 Aout 2025)
• Lettre d’appel urgent conjoint relatif à la situation des personnes déplacées de Khar Yalla, Sénégal. (Sénégal ,11 Septembre 2025)
• Lettre d’appel urgent conjoint adressée au Sénégal, avec le Comité d'Experts africains sur les droits et le bien-être de l'enfant (Rapporteur Sénégal) concernant le décès du jeune talibé Abdou Khadr Seck et la protection des enfants talibés au Sénégal. (Sénegal,30 septembre 2025)
• Lettre d’appel urgent conjoint adressée au Tchad concernant la déchéance de la nationalité tchadienne de Messieurs Charfadine Galmaye Saleh et N’Guebla Makaïla. (Tchad, 2 octobre 2025)
2) Déclarations et Communiqués de Presse
• Communiqué de presse sur la situation dans l’Etat de Libye (Libye, 17 mai 2025)
• Communiqué de presse conjoint sur la découverte de plusieurs fosses communes et des corps non identifiés dans la localité d’Abu Salim, Tripoli, Etat de Libye (Libye, 31 mai 2025)
• Communiqué de presse sur la disparition de plus de soixante (60) migrants au large des côtes libyennes, (Libye,19 juin 2025)
• Déclaration de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés (20 juin 2025)
• Déclaration de PIERR (Plate- forme des experts indépendants pour les droits des réfugiés) à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, « Now Is the Time to Uphold the Rule of Law for Refugee Protection : UN and Regional Experts » (20 juin 2025)
• Communiqué de presse sur les violences policières survenues dernièrement en République du Sénégal (Sénégal, 10 juillet 2025)
• Communiqué de presse sur l’expulsion de migrants africains et non-africains par les Etats-Unis d’Amérique vers des Etats africains (4 aout 2025)
• Communiqué de presse sur le naufrage au large de Nouakchott entrainant le décès de plus de 70 migrants et des dizaines de disparus, (Mauritanie, 1 septembre 2025)
• Communiqué de presse sur la poursuite des accords migratoires entre certains États africains et les États-Unis d’Amérique, (1 septembre 2025)
• Communiqué de presse sur le massacre de 22 villageois dans la région de Tillabéri en République du Niger (Niger,18 septembre 2025)
• Communiqué de presse sur le décès d’au moins 50 migrants soudanais au large de Tobrouk, dans l’Est de l’Etat de Libye, (Libye, 18 septembre 2025)
• Communiqué de presse conjoint dans le cadre de PIERR et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, “Experts de la CIDH et des Nations Unies : les États doivent protéger les droits des personnes en situation de mobilité humaine”, (18 septembre 2025)
3) Lettres de félicitations
• Lettre de félicitations pour la République du Cameroun pour son adhésion aux deux Conventions des Nations Unies relatives au statut des apatrides et à la réduction des cas d’apatridie, adoptées respectivement le 28 septembre 1954 et le 30 aout 1961. (Cameroun, 8 mai 2025).
• Lettre de félicitation à la république du Zimbabwe pour la ratification de la Convention des Nations Unies sur la protection des travailleurs migrants et les membres de leurs familles (1990) (Zimbabwe, 12 mai 2025)
• Lettre de Félicitations à son Excellence l’Ambassadrice Amma Twum-Amoah à l’occasion de son élection à la fonction de Commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social au sein de la CUA, en l’assurant de la disposition de la Commission à travers mon mandat pour renforcer et multiplier la coopération avec la CUA dans le cadre d’initiatives communes, au bénéfice des réfugiés, demandeurs d’asile, déplacés internes et migrants à travers le continent. (3 juillet 2025)
4) Autres correspondances
• Lettre à son Excellence l’Ambassadrice Amma Twum-Amoah, Commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social au sein de la CUA, pour programmer une réunion de discussion sur la thématique des migrants disparus en Afrique. (31 juillet 2025)
B. ACTIVITES DE PROMOTION
Etat de la ratification des Conventions et Protocoles sous la responsabilité du mandat
a) La Convention de l’Union africaine sur la Protection et l’assistance aux personnes déplacées internes en Afrique (Convention de Kampala)
6. A ce jour, trente-quatre (34) Etats ont ratifié la Convention de Kampala , dix (10) Etats l’ont seulement signée , et onze (11) Etats ne l’ont toujours ni signée ni ratifiée. Nous tenons à souligner par ailleurs, qu’à ce jour, seulement trois (3) Etats ont présenté leur rapport initial au titre de l’article 14 (4) de la Convention de Kampala dans le cadre de l’obligation générale de l’article 62 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, il s’agit de la République du Cameroun, de l’Angola et du Burkina Faso.
7. Nous félicitons ces Etats et invitons les autres à suivre la même démarche pour se conformer à leurs obligations découlant de la Convention de Kampala et assurer un meilleur suivi de ses dispositions afin d’améliorer la situation des personnes déplacées internes en Afrique.
b) Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant sur les aspects spécifiques du droit à une nationalité et l’éradication de l’apatridie en Afrique
8. Adopté lors de la 37ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union africaine, tenue du 17 au 18 février 2024 à Addis-Abeba, le Protocole représente un moment historique et une avancée majeure pour l’Afrique sur le plan juridique, qui se dote désormais d’un instrument contraignant assurant à la fois, la promotion, la protection et le respect du droit à une nationalité à tout individu, condition fondamentale pour la protection et l’exercice effectif de l’ensemble des autres droits humains ( établissement de papiers d’identité, éducation, santé, emploi, protection sociale, droits politique (vote/élection) et d’autre part, la prévention et l’éradication de l’apatridie, contraire au respect du droit à la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de la personnalité juridique. En effet, avant l’adoption de ce protocole, le droit à la nationalité n’était pas entièrement reconnu sur le continent comme un droit fondamental de la personne et le cadre existant actuellement ne permet pas aux personnes de se protéger efficacement.
9. Alors que nous commémorons cette année le premier anniversaire de cette adoption, le Protocole n’enregistre toujours aucune signature ni ratification. Nous réitérons donc nos appels à La Commission de l’UA, au HCR, aux organisations de la société civile, et à tous les autres partenaires, pour apporter leur soutien et contribution afin de mener un véritable plaidoyer dans la campagne de ratification de cet instrument fondamental, s’inscrivant ainsi dans la concrétisation de l’Alliance mondiale pour mettre fin à l’apatridie, lancée le 14 octobre 2024.
C. AUTRES ACTIVITES
1) Participation à des réunions, conférences et séminaires en présentiel
10. 12 juin 2025, Bruxelles, Belgique, participation en ma qualité de Rapporteur pays à la Conférence internationale sur le droit à un procès équitable, consacrée cette année à la Tunisie, organisée par International Fair Trial Day (IFTD). Lors de cette conférence, j’ai prononcé le discours inaugural réaffirmant que le droit à un procès équitable est la clé de voûte de l’État de droit et la condition d’effectivité de l’ensemble des droits fondamentaux. J’ai rappelé ses piliers (indépendance et impartialité des juridictions, droits de la défense, présomption d’innocence, délai raisonnable, publicité des débats, égalité des armes) et son ancrage juridique notamment à travers la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 7 et 26 de la Charte africaine). Le rôle de la CADHP a été souligné à travers notamment : Les Principes et lignes directrices sur le droit à un procès équitable et à l’assistance juridique en Afrique (2003) qui viennent renforcer et compléter les dispositions de la Charte africaine ; sa jurisprudence riche en matière de communications individuelles dénonçant des procès inéquitables dans plusieurs affaires: Nigeria, en Gambie, au Zimbabwe, en RDC ou ailleurs ; son rôle dans l’alerte et les appels urgents adressés aux les États qui violent de manière flagrante le droit à un procès équitable ; Ou encore dernièrement à travers la nomination d’un point focal sur l’indépendance judiciaire en Afrique (CADHP/Res.570/2023). J’ai alerté sur les atteintes récurrentes en Afrique (procès politiques, pressions exécutives, entraves à l’assistance d’avocat, délais excessifs), évoquant à titre illustratif des préoccupations en Tunisie. J’ai appelé enfin à des réformes garanties par la séparation des pouvoirs, à des institutions impartiales et accessibles, à la lutte contre l’impunité, et à un accès effectif à la justice, afin que le procès équitable reste un rempart contre l’arbitraire et un vecteur de dignité humaine.
11. 23 Juin 2025, Genève, Suisse, Participation à une Table ronde sur « Unlocking Rights : Due process and Human rights of refugees deprived of liberty », co-organisée par la Plate- forme des Experts indépendants pour la protection des droits des réfugiés PIERR, et Geneva Graduate Institute (Global Migration Centre), Genève. La table ronde était l’occasion d’échanger avec des académiciens, le HCR ainsi que des Rapporteurs spéciaux des Nations Unies et les membres de PIERR sur la question de la détention des réfugiés et demandeurs d’asile. Je suis intervenue lors de cette table ronde pour exposer les tendances africaines observées en matière de privation de liberté des réfugiés et demandeurs d’aile ainsi que les préoccupations soulevées. Plusieurs aspects ont été soulignés, notamment : la criminalisation croissante de de la migration irrégulière et l’intensification des contrôles aux frontières de la part des Etats africains, prétextant leur souveraineté, la préservation de la sécurité nationale et de l’ordre public ou encore la lutte contre le terrorisme, et engendrant par la même des risques accrus pour les réfugiés et demandeurs d’asile de traite, trafic, disparitions forcées, stigmatisation… ; le recours excessif à la détention des réfugiés et demandeurs d’asile comme première réponse aux afflux massifs et aux flux migratoires. La détention est utilisée en tant que mesure automatique, systématique, répressive et préventive, souvent prolongée et arbitraire, utilisée même pour les femmes et les enfants séparés ou non accompagnés, et le non recours aux alternatives à la détention ; les conditions de détention ne respectant pas les standards internationaux et régionaux. J’ai rappelé les différents textes africains relatifs à la question de la détention des réfugiés, de nature générale ou plus spécifique, notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la Convention de l’OUA sur les aspects spécifiques aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969), ou encore les instruments de soft law adoptés par la CADHP en particulier l’Observation générale n°5 sur la liberté de circulation (art 12), les Principes directeurs africains sur les droits de l’homme de tous les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile (2023), les Principes de Luanda (2014) sur les conditions d’arrestation et de détention provisoires contenant des dispositions spécifiques pour les réfugiés et demandeurs d’aile compte tenu de leur vulnérabilité, ou encore l’étude relative à l’impact de l’application de la loi sur les droits humains des réfugiés, demandeurs d’asile et des migrants en Afrique(2024) . Enfin, j’ai terminé sur une note positive en partageant quelques bonnes pratiques dans un certain nombre de pays africains qui ont adopté des lois et des politiques sur les alternatives à la détention des réfugiés et demandeurs d’asile, parfois même pour ceux qui sont entrés de manière irrégulière (Ouganda, Ethiopie, Kenya, Zambie, Cameroun), et en présentant une vision pour l’avenir fondée sur la protection des droits de réfugiés et demandeurs d’asile.
12. 24 juin 2025, Genève, Suisse, Participation à un Side Event organisé par PIERR, en marge de la 59ème session du Conseil des Droits de l’Homme, et ayant comme thème « Etat de droit, droits de l’homme et protection des réfugiés ». J’ai présenté lors de ce side event les perspectives de la région d’Afrique sur la question, en commençant par rappeler que l’Afrique est un continent de départ, de transit mais aussi d’accueil, avec près de 8 millions de réfugiés, souvent installés dans des pays aux ressources très limitées et en situation de fragilité économique, politique et sécuritaire. J’ai également mis l’accent sur le fait qu’en dépit d’un corpus juridique solide et varié sur la protection des réfugiés (Charte africaine, Convention de l’OUA de 1969, Principes directeurs africains sur les droits de l’homme de tous les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, 2023), renforcé par un cadre institutionnel assez robuste, la réalité et la mise en œuvre demeurent inégales et de nombreuses entorses à l’Etat de droit sont encore pratiquées au détriment des droits des réfugiés, telles : absence de lois d’asile dans certains pays africains, notamment ceux du nord, menant à un accès inégal à la justice ; procédures d’asile inéquitable et discriminatoires, parfois même une pratique de xénophobie ; la criminalisation de plus en plus croissante de la migration irrégulière ; la généralisation de la détention pour cause migratoire, sans distinction de statut, y compris des femmes et des enfants, avec un accès très limité à des recours effectifs, à une représentation juridique, à un procès équitable, le tout accentué souvent par la barrière linguistique. J’ai rappelé encore une fois que la détention des réfugiés et demandeurs d’asile ne devrait qu’être une mesure exceptionnelle et de derniers recours, et remplacée à chaque que c’est possible par des alternatives à la détention, beaucoup plus humaines et respectueuses de la dignité ; les pouvoirs trop étendus et discrétionnaires accordés aux agents d’application de la loi, menant souvent à des refoulements, des expulsions collectives. A la fin, j’ai mis en exergue certaines bonnes pratiques suivies par des Etats africains qui renforcent leurs législations afin d’assurer les droits des réfugiés sur la base du respect de l’Etat de droit, notamment par l’amélioration des procédures d’asile, ou encore par l’inclusion socio-économique, en parfaite adéquation avec la Résolution 565 sur l’inclusion des réfugiés, des demandeurs d'asile, des déplacés internes et des apatrides dans les systèmes socio-économiques nationaux, les services et les opportunités économiques en Afrique - CADHP/Res.565 (LXXVI) 2023.
13. 24 juin 2025, Genève, participation à une réunion pour la mise en place de l’initiative Friends of PIERR. La réunion a vu la participation, outre des membres de la PIERR et des agences onusiennes (OHCHR, OIM), les Ambassadeurs et représentant d’Etat du Chili, de l’Espagne, du Japon et de la Colombie. Aucun Etat africain n’était présent. La réunion a porté essentiellement sur les meilleures stratégies à suivre pour engager avec les Etats sur les différentes questions liées à la protection des réfugiés, et l’importance du dialogue entre les différentes parties prenantes.
14. 24 juin 2025, Genève, Suisse, participation à une réunion interne des membres de la PIERR. La réunion s’est focalisée essentiellement sur le renforcement de l’initiative de Friends of PIERR et notamment l’implication d’Etats africains et européens. La discussion a porté par ailleurs sur les futures activités à venir de PIERR et certaines questions prioritaires.
15. 9-10 juillet 2025, Banjul, Gambie, participation à la Réunion thématique : Unir les efforts : Faire avancer la coopération sur la question des personnes migrantes disparues dans la région du Processus de Rabat. Cette Réunion thématique, co-présidée par la Gambie et la Suisse et avec le soutien actif du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a réuni plus de 100 participants de 27 pays européens et africains, y compris les Points Focaux Nationaux (PFN) du Réseau pour les Personnes migrantes disparues et des experts issus d’organisations nationales, régionales et internationales, d’organisations de la société civile, et des membres des familles des personnes migrantes disparues.
Intervenant dans la session 1 consacrée à la thématique des “Personnes migrantes disparues dans la région du Processus de Rabat : comprendre le contexte”, en tant que Keynote, la lumière a été mise sur la crise croissante relative aux personnes migrantes disparues le long des routes migratoires africaines et européennes, représentant une tragédie humaine transnationale et une urgence humanitaire, mettant en péril le droit à la vie, à la sécurité, à la dignité et, dans certains cas, le principe de non-refoulement. J’ai rappelé par ailleurs que chaque année, des milliers de personnes disparaissent ou perdent la vie le long des périlleuses routes migratoires en Afrique, ou vers l’Europe – que ce soit en mer, dans le désert ou des zones de transit éloignées– où leur destin demeure souvent inconnu. Derrière ces chiffres se trouvent des vies interrompues et des familles laissées dans une détresse prolongée, souvent incapables de débuter leurs processus de deuil en absence d’informations sur leurs proches.
16. J’ai insisté en outre sur le fait que ces disparitions ne sont pas seulement des tragédies individuelles, elles reflètent également un échec collectif plus large, celui d’une gouvernance migratoire contemporaine qui ne parvient pas à assurer la protection, la dignité et les droits humains pour tous. Les politiques migratoires restent largement dominées par des approches sécuritaires, souvent au détriment de la solidarité, de la protection et de la responsabilité.
J’ai appelé lors de cette réunion à une responsabilité partagée et collective entre les pays d'origine, de transit et de destination, et invité à une réorientation vers des cadres de gouvernance migratoire fondés sur la solidarité, la coopération et la priorité accordée à la dignité et à la sécurité des personnes migrantes, quel que soit leur statut juridique.Les références clés suivantes ont été mises en avant :
- Résolution 486 (2021) de la Commission africaine sur les personnes migrantes et réfugiées disparues en Afrique et l'impact sur leurs familles, reconnue comme une étape importante dans les efforts régionaux pour répondre à cette crise.
- Les Principes directeurs africains relatifs aux droits de l'homme de tous les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile (2023), avec un accent particulier sur le principe 9, qui traite spécifiquement des personnes migrantes disparues et des disparitions.
Ces instruments trouvent leur origine dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en particulier dans l'article 4 (droit à la vie et à l'intégrité de la personne), l'article 5 (dignité), l'article 6 (liberté et sécurité) et l'article 18 (protection de la famille).Des discussions riches, conclusions, bonnes pratiques et recommandations clés sont sorties de cette réunion en insistant sur un objectif principal et clair qui est celui de veiller à ce qu’aucune personne migrante ne soit oubliée, qu’aucune famille ne reste sans réponses, et qu’aucun effort ne soit négligé pour prévenir de futures tragédies, ainsi que sur la nécessité de renforcer les systèmes régionaux et nationaux et pour les pays partenaires du Dialogue de rejoindre le Réseau des Points Focaux Nationaux pour les Personnes migrantes disparues.
17. 27-28 septembre 2025, Accra, Ghana, participation à la Conférence sur le plaidoyer en faveur de la ratification et de la mise en œuvre continentales des traités sous supervision de la CADHP, qui avait comme thème : Vers la ratification et la mise en œuvre universelles de tous les traités africains relatifs aux droits de l'Homme. J’ai pris part aux travaux de conférence notamment le segment consacré à la cartographie des progrès réalisés et des défis rencontrés dans la mise en œuvre des instruments sous supervision de la CADHP. En ma qualité de Rapporteuse spéciale sur les réfugiés, demandeurs d’asile, personnes déplacées et migrants en Afrique, j’ai présenté l’état de ratification et d’application du Protocole relatif au droit à une nationalité et à l’éradication de l’apatridie, de la Convention de Kampala sur les déplacés internes et de la Convention de l’OUA sur les réfugiés. J’ai insisté sur la nécessité d’accélérer les ratifications en suspens, de renforcer la domestication des traités ratifiés et de consolider les mécanismes nationaux de suivi. Les échanges ont permis de dégager des pistes concrètes de plaidoyer et d’assistance technique aux États, en vue d’une meilleure protection des réfugiés, des personnes déplacées et des apatrides sur le continent africain.
2) Participation aux webinaires, conférences et autres réunions
18. 28 mai 2025, j’ai pris part à une réunion en ligne de la Plate-forme des experts indépendants pour les droits de réfugiés (PIERR). La réunion a vu la participation des différents membres de la plate-forme ainsi que des représentants du HCR. Elle avait comme objectifs d’abord la présentation des nouveaux membres, notamment l’extension de la plate-forme à la région de l’Europe, avec la participation du Conseil de l’Europe à travers le CPT (Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). Les différents membres ont par la suite fait un récapitulatif de leurs activités et missions, et c’était l’occasion pour moi de rappeler toute une gamme de rapports, communiqués, réunions en lien avec les réfugiés et demandeurs d’asile. La discussion a également porté sur la politique des Etats-Unis en matière de protection des réfugiés, j’ai ainsi souligné les répercussions que pourrait avoir cette politique sur les droits humains des réfugiés et migrants notamment dans le contexte des différents accords conclus entre un certain nombre d’Etats africains et les USA portant expulsion de migrants africains et non-africains par les Etats-Unis d’Amérique vers des Etats africains. Enfin, la réunion a permis la présentation des actions et activités à venir de la PIERR, notamment la conclusion de MoU avec les universités, et le lancement de l’inititative Member States Friends of the PIERR Group.
19. 26 juin 2025, participation en ligne à une réunion hybride sur l’initiative « Migrants disparus » mise en œuvre avec la Commission de l’Union africaine (CUA), le CICR et l’OIM. La réunion a vu la participation des représentants de l’OIM Addis-Abeba, Berlin et du CICR. L’objectif de la réunion était de présenter la mise à jour sur l’initiative des migrants disparus avec un passage d’une Position Africaine Commune sur la question à un projet de « Lignes directrices » pour appuyer les Etats. J’ai rappelé les actions de la CADHP sur la question des migrants disparus, notamment la Résolution 486 (2021) ainsi que les Principes directeurs africains sur les droits de l’homme de tous les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile (2023) qui contiennent un Principe 9 consacré à la thématique. Les étapes à venir ont été discuté pour planifier au mieux la participation de la CADHP à cette initiative.
20. 27 juin 2025 et 2 juillet 2025, participation en ligne à des réunions de coordination en vue de la préparation de la réunion thématique sur les migrants disparus, organisée dans le cadre du Processus de Rabat, du 9-10 juillet 2025 à Banjul, Gambie.
21. 15 juillet 2025, participation en ligne à une réunion avec Cornell Law School, ayant pour objectif principal une discussion sur la dissémination des Principes directeurs africains relatifs aux droits de l’homme de tous les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, lancés par la CADHP en 2023. Différentes pistes ont été avancées notamment un projet de collaboration avec l'IIHL Institut International de Droit Humanitaire de San Remo et les collègues de Pretoria pour un webinaire promouvant les Principes directeurs et d’éventuelles activités en marge de la 85ème SO de la CADHP.
22. 16 juillet 2025, participation à une réunion en ligne avec l’Institut International de Droit Humanitaire de San Remo en vue de collaborer à la 45ème édition du Cours online sur le droit international des réfugiés, prévu du 29 septembre au 24 octobre 2025, notamment en intervenant dans la session « La protection des réfugiés en Afrique : défis pratiques et réponses juridiques ».
23. 30 juillet 2025, participation en ligne à une Table ronde organisée par Amnesty International, à l’occasion du lancement de son rapport de recherche intitulé « Même ici, nous souffrons : La lutte pour les droits humains des personnes déplacées internes en raison du changement climatique dans le Sud de Madagascar », avec un focus sur la population Antandroy. La table ronde a connu la participation des organisations de la société civile malgache, Amnesty International, la Comité Africain d'Experts sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant. Mon intervention lors de cette table ronde a mis l’accent sur la stratégie de la CADHP sur les questions du déplacement interne fondée essentiellement sur la Convention de Kampala. J’ai également rappelé que la Commission est en phase de finalisation d’une étude sur les droits de l’homme et les changements climatiques, ainsi que la Résolution 628/2025 pour l’élaboration d’une étude sur le développement d’un cadre juridique spécifique à la protection des personnes déplacés de force en Afrique pour cause de changement climatique, afin d’assurer un accès à une justice climatique, notamment eu égard aux développement de la jurisprudence internationale sur la question particulièrement suite à l’Avis consultatif de la CIJ et la demande d’avis consultatif auprès de la Cour africaine des DHP sur les obligations des Etats africains en matière de protection des droits de l’homme en période de crise climatique. Enfin, j’ai mis en lumière les différents outils utilisés par la Commission pour appeler à la protection des personnes déplacés internes à cause des catastrophes naturelles dues au changement climatique (Rapports des Etats à travers la partie C, communiqués de presse et appels urgents, plaidoyer pour la ratification et la mise en œuvre de la Convention de Kampala notamment par l’adoption de lois nationales en prenant appui sur la loi type de 2018 sur le déplacement interne adoptée par l’UA…). En guise de conclusion, j’ai invité le Gouvernement de Madagascar à ratifier la Convention de Kampala, la mettre en œuvre, à la recherche de solutions durables pour les personnes déplacés pour cause de changement climatiques en les impliquant dans le processus décisionnel. J’ai par ailleurs encouragé les ONG présentes à se rapprocher davantage de la CADHP afin de partager les défis auxquels sont confrontées certaines populations et sensibiliser sur la question du déplacement pour cause de changement climatique.
24. 7 août 2025, participation à une réunion en ligne avec Human Rights Watch portant sur un briefing sur la situation des déplacés climatiques à Saint Louis, au Sénégal, suivi d’une discussion sur les pistes à explorer par la Commission pour alerter le Gouvernement sénégalais sur la question.
25. 4 septembre 2025, participation en ligne à une réunion des Etats membres de l’UA sur la question des migrants disparus en Afrique. La réunion a été organisée par l’UA en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Elle a réuni des experts, des décideurs politiques et des parties prenantes clés pour partager leurs expériences, leurs meilleures pratiques et leurs stratégies pour prévenir les disparitions de migrants et soutenir les familles touchées. J’ai mis en lumière la Résolution 486 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) adoptée en juillet 2021, qui aborde la question des migrants et des réfugiés disparus en Afrique et l'impact sur leurs familles et qui exhorte les États membres de l'UA à prendre des mesures pour empêcher les personnes de disparaître, protéger les droits de l'homme pendant la migration, coordonner les efforts pour identifier les personnes disparues et soutenir les familles. J’ai également rappelé les Principes directeurs africains sur les droits de l’homme de tous les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile (2023), notamment leur Principe 9 consacré à la question des migrants disparus. La réunion s'est conclue par une recommandation ferme à la Commission de l'Union africaine d'accélérer la mise en place d'une directive continentale sur les migrants disparus qui renforcera la coordination des États membres de l'UA, des CER et d'autres parties prenantes clés, la recherche et le sauvetage, la collecte de données et l'échange d'informations, ainsi que la protection des personnes touchées et de leurs familles.
26. 17 septembre 2025, participation à une réunion en ligne avec Human Rights Watch pour une discussion générale sur le rapport publié sur la situation des migrants en Mauritanie et intitulé « Ils m’ont accusé de tenter de rejoindre l’Europe’ : Abus liés au contrôle des migrations en Mauritanie et à la politique d’externalisation de l’UE » .
27. 22 septembre 2025, participation à une réunion en ligne avec l’Agence de l’Union Européenne pour l’asile (European Union Agency for Asylum EUAA). L’objet de la réunion était d’établir un premier contact avec la CADHP en vue de futures collaborations et coopérations. Après un bref échange sur les mandats des deux institutions, l’EUAA a présenté le “Projet régional de protection de l'EUAA pour le voisinage Sud (Regional Protection Project for the Southern Neighbourhood (RPSN))” qui vise à aider les pays partenaires à renforcer l'environnement de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés dans le voisinage Sud et le long des routes migratoires, en mettant particulièrement l'accent sur les groupes vulnérables, et conformément au droit international et aux normes de l'UE. Le RPSN cherche à consolider davantage une plateforme d'échange entre les pays non membres de l'UE+ ( ceux ayant confirmé leur participation seraient: Algérie, Égypte, Libye, Mauritanie et Maroc) et les États membres participants de l'UE+ ( Autriche, Belgique, Tchéquie, Danemark, Allemagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie et Suède) , afin de soutenir l'identification de solutions sur mesure pour améliorer la gestion des procédures d'asile en tenant compte des contextes régionaux et nationaux, ainsi que des besoins des groupes vulnérables. Le lancement officiel du projet RPSN est prévu pour les 26-27 novembre 2025.
28. 23 Septembre 2025 : participation via un enregistrement vidéo à la 45ème édition du Cours en ligne sur le droit international des réfugiés, prévu du 29 septembre au 24 octobre 2025, organisé par l’Institut International de Droit Humanitaire de San Remo. Dans ma contribution, j’ai rappelé le rôle et la nature du mandat de la Rapporteure Spéciale sur les réfugiés, demandeurs d’asile, PDI et migrants en Afrique, en précisant qu’il s’agit d’une fonction indépendante, exercée pour une durée déterminée, et visant à promouvoir, protéger et faire progresser les droits fondamentaux des personnes concernées. J’ai également souligné l’importance de ce mandat aujourd’hui dans le contexte africain, marqué par des défis persistants liés aux migrations, aux déplacements forcés et aux violations des droits humains. Dans mon intervention, j’ai partagé plusieurs expériences de terrain, notamment des missions et des situations suivies, illustrant concrètement la portée du travail accompli. J’ai aussi évoqué les actions de plaidoyer menées auprès des États membres à travers la présentation de rapports, l’émission de recommandations et la publication de déclarations publiques. Par ailleurs, j’ai insisté sur le suivi attentif des situations critiques, telles que les disparitions, expulsions ou autres violations graves des droits. J’ai enfin mis en avant l’importance de l’interaction directe avec les réfugiés et les migrants, à travers des consultations et des échanges visant à recueillir leurs préoccupations, ainsi que la nécessité d’une coordination étroite avec les gouvernements, les mécanismes africains et les partenaires internationaux pour renforcer la protection des droits humains sur le continent.
3) Participation aux sessions et autres réunions de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples
29. 2-3 juin 2025, en ligne, participation à la retraite avec la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples portant sur la complémentarité entre les deux institutions. La retraite a notamment examiné les progrès réalisés par les deux organes dans le renforcement de leurs relations et l'état de la mise en œuvre de la Feuille de route de la complémentarité adoptée lors de la première retraite tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 10 au 14 octobre 2022. La retraite a abouti à l’adoption par les deux organes des “Lignes directrices sur la soumission d'affaires par la Commission à la Cour et le transfert d'affaires par la Cour à la Commission”.
30. 17 juin 2025, participation à une réunion préparatoire de la CADHP à la concertation avec le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, prévue pour le 19 juin 2025.
31. 19 juin 2025, participation à une Réunion de consultation avec le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, en ligne. Les échanges entre les deux organes ont porté sur différentes questions notamment (i) le renforcement des synergies institutionnelles et des échanges d’information réguliers entre le CPS et la CADHP ; (ii) l’ancrage d’une approche fondée sur les droits à toutes les étapes du cycle des conflits (alerte, prévention, gestion, résolution, reconstruction) ; (iii) le traitement des causes profondes des conflits (privation de droits, inégalités, discriminations) et la protection des groupes vulnérables (femmes, enfants, PDI, réfugiés, migrants, personnes handicapées, etc.) ; (iv) le respect du DIH/DIDH par les belligérants ; (v) le rôle de la CADHP en justice transitionnelle (soutien technique aux États) ; et (vi) les défis financiers de la CADHP et des pistes pour un financement plus prévisible, avec l’idée d’institutionnaliser une consultation annuelle CPS–CADHP et d’appeler les États à coopérer pleinement surtout en assurant la mise en œuvre des décisions des organes politiques de l'UA, afin de faciliter le travail de la CADHP. Voir communiqué final.
32. Du 21-30 juillet 2025, participation à la 84ème session ordinaire (privée) CADHP, Voir communiqué final.
33. 19 septembre 2025, participation à la 38ème Session extraordinaire de la CADHP, tenue virtuellement 19 septembre 2025. Les travaux de ladite Session ont essentiellement porté sur des questions techniques, notamment l’adoption des termes de référence du Forum de présession des États parties ainsi que l’examen du document sur les motifs proposés pour la saisine de la Cour africaine. La session a servi d’échanges sur les modalités de publication du rapport de la Mission Conjointe d’Établissement des Faits sur la Situation des Droits de l’Homme au Soudan ainsi que la planification et l’alignement des dates de la prochaine session avec les différentes activités organisées en prélude, notamment les forums des Etats, des INDH et des ONGs . Voir communiqué final.
34. Du 7 au 15 octobre 2025, participation à la session privée de la 85ème session ordinaire de la CADHP, Voir communiqué final
III. ACTIVITES EN QUALITE DE MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
35. 25-26 septembre 2025, Accra, Ghana, participation en qualité de Vice-Présidente du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique de la CADHP, à un atelier continental sur les droits socio-économiques des femmes y compris dans le contexte des industries extractives. L’atelier a réuni des commissaires de la CADHP, des représentants d’États, d’INDH, d’organes de l’UA, de mécanismes onusiens, d’OSC, d’universitaires et du secteur privé extractif. À cette occasion, j’ai modéré la Session 4 consacrée à « L’éducation comme catalyseur de changement », qui a porté sur les progrès, défis et solutions pour l’accès des femmes et des filles à une éducation de qualité, en lien avec la CESA 16-25 et le Cadre d’action Éducation 2030, aux côtés d’universitaires et d’INDH intervenant sur les obstacles socio-culturels et les pistes d’action. Dans mon intervention de cadrage, j’ai souligné l’articulation éducation–santé et protection sociale et la nécessité d’aligner les cadres de l’UA (Charte, Protocole de Maputo, protection sociale) avec les politiques nationales, d’accélérer ratification/domestication, d’adopter une approche intersectionnelle, et de mettre en place un mécanisme de suivi avec indicateurs sensibles au genre, y compris dans les zones ou des femmes sont actives dans les industries extractives. Les travaux de l’atelier ont produit des recommandations opérationnelles : priorité budgétaire à l’éducation (qualité, abolition des frais, formation des enseignants, solutions EdTech), investissements en SDSR et systèmes de santé inclusifs, réformes des droits de propriété et du travail (harmonisation juridique, protection du secteur informel, parité), et gouvernance des industries extractives fondée sur la participation communautaire, la transparence (notamment sur les flux financiers illicites) et la responsabilité des entreprises ; il a aussi été demandé à la CADHP de développer des lignes directrices/lois modèles, d’organiser des auditions périodiques sur les entreprises transnationales et de conduire des visites dans les pays affectés.
36. 3-4 octobre 2025, Cape Town, Afrique du Sud, participation en qualité de Vice-Présidente du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels, à une réunion de consultation sur l’étude de la CADHP sur l’intégration des droits économiques sociaux et culturels dans les plans nationaux de développement en Afrique. La réunion a vu la participation des partenaires de la CADHP sur le projet, à savoir, le Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme (RINADH), Centre for Human Rights (Université de Prétoria) et le Danish Institute for Human Rights. La réunion avait comme objectif de présenter un nouveau draft suite aux commentaires sur le premier draft présenté à Dakar en décembre 2024, ainsi que l’introduction de nouveaux cas d’étude. La réunion s’est clôturée par l’adoption d’une feuille de route pour la poursuite du processus menant à l’adoption de ladite étude.
37. 5- 7 octobre 2025, Cape Town, Afrique du Sud, participation en qualité de Vice-Présidente du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels, à un ensemble de réunions en marge du XXV Congrès Mondial de la FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique), notamment : une réunion de lancement sur l’élaboration de Lignes directrices pour l’élimination de la violence obstétricale et la promotion des soins de santé maternelle en Afrique, coorganisé avec le Center for Reproductive Rights, et une autre réunion consultative entre la CADHP et la FIGO avec le concours des partenaires du Center for Reproductive Rights et International Childbirth Initiative, ayant pour objectifs informer la Commission sur les expériences et les défis systématiques auxquels sont confrontés les praticiens en matière de santé maternelle, ainsi que la récolte de recommandations pour la promotion de soins de santé maternelle de qualité et respectueux des droits des femmes et des filles.
IV. ÉVALUATION DES DROITS DE L’HOMME SUPERVISES PAR LE MECANISME EN AFRIQUE
Analyse de la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile, des personnes déplacées internes et des migrants durant la période d’intersession
38. La combinaison persistante des conflits armés, des violences sociopolitiques, de la dégradation socioéconomique et du changement climatique continue de générer des déplacements massifs de populations en Afrique. En avril 2025, le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) estimait le nombre global de personnes déplacées de force (réfugiés, déplacés internes, demandeurs d’asile) à 122,1 millions . Dans ce contexte, les personnes en mouvement subissent régulièrement des violations graves de leurs droits, parmi lesquelles enlèvements, exécutions arbitraires, extorsions, violences sexistes et conditions de vie précaires dans les camps formels ou informels. Nombre d’entre elles, notamment les enfants, se trouvent privées d’accès effectif aux droits fondamentaux tels que l’éducation et la santé.
39. Cette crise est aggravée par un sous-financement humanitaire exacerbée : le Global Humanitarian Overview 2025 indique qu’à mi-année, seuls 18,5 % des 29,1 milliards USD requis ont été mobilisés, alors que les besoins ne cessent d’augmenter . Ces défis sont particulièrement aigus dans des États tels que le Soudan, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, la Somalie et l’Éthiopie, où les crises de déplacement persistent et se complexifient sous l’effet de multiples facteurs.
1) Réfugiés
40. Durant cette période d’intersession, la situation des réfugiés et demandeurs d’asile dans le continent demeure préoccupante en raison de la persistance des conflits armés, de la dégradation des conditions socioéconomiques et du sous-financement humanitaire chronique. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a signalé en 2025 que plus de 44 millions de personnes déplacées forcées vivent sur le continent africain, dont près de 12 millions de réfugiés et plus de 30 millions de déplacés internes .
41. En Afrique de l’Ouest, la situation reste marquée par de nouvelles vagues de déplacement transfrontalier. L’afflux de réfugiés ghanéens vers le nord de la Côte d’Ivoire a entraîné une aggravation des tensions locales : plus de 13 000 personnes, majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées issues de l’ethnie Birifor, ont fui la région ghanéenne des Savanes à la suite d’affrontements intercommunautaires entre Birifor et Gonja . Ces nouveaux arrivants s’ajoutent à la présence d’environ 30 000 réfugiés burkinabés déjà installés dans les villages du nord ivoirien, saturant les capacités d’hébergement et exacerbant les vulnérabilités sociales et économiques des communautés hôtes.
42. Au Mali, la région de Bandiagara continue d’accueillir un afflux massif de réfugiés burkinabés, estimé à jusqu’à 1 500 personnes par jour au plus fort de la crise d’août 2025. Entre le 5 et le 31 août, le nombre de réfugiés enregistrés est passé de 1 733 à plus de 12 000, principalement des femmes et des enfants ; ces arrivées s’ajoutent aux 83 417 réfugiés déjà présents, portant la population déplacée à plus de 100 400 personnes .
43. Au Tchad, la propagation du choléra dans les camps accueillant des réfugiés soudanais en provenance du Darfour a aggravé la situation sanitaire : au 20 août 2025, 821 cas suspects et 56 décès étaient signalés, avec un taux de létalité de 6,8 %. Les fortes pluies et la surpopulation dans les camps ont favorisé la diffusion de l’épidémie .
44. Au Niger, le centre humanitaire d’Agadez continue d’accueillir plusieurs centaines à quelques milliers de réfugiés - en grande majorité des Soudanais - dans un contexte de ressources réduites et de contraintes administratives sévères . Les conditions de vie y sont caractérisées par un accès limité aux services de santé et à l’éducation, une assistance alimentaire réduite à des quotas minimaux, et une forte insécurité juridique liée à l’absence de perspectives claires de relocalisation ou de retour volontaire . En août 2025, les autorités nigériennes auraient procédé à l’arrestation de six réfugiés soudanais, accusés d’avoir organisé des manifestations pacifiques pour revendiquer de meilleures conditions .
45. Au Kenya, au cours des cinq dernières années, le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile a augmenté de plus de 70 %, passant d’environ 500.000 à 843.000 personnes, qui ont fui les conflits et la sécheresse dans les pays voisins comme la Somalie et le Soudan du Sud. . Dans ce contexte, le sous-financement frappe de plein fouet l’assistance humanitaire. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a réduit les rations alimentaires dans les camps de Dadaab et Kakuma (Kenya) à seulement 28 % des besoins, sans distribution complémentaire en espèces, affectant directement environ 720 000 réfugiés et augmentant les risques de malnutrition aiguë et de famine .
46. La situation humanitaire des réfugiés sahraouis dans les camps demeure critique et constitue l’une des crises de réfugiés de longue durée les plus anciennes en Afrique et au monde, persistant depuis près d’un demi-siècle. Malgré des efforts humanitaires soutenus, la population reste dépendante de l’aide internationale, dans un contexte de sous-financement chronique : le Sahrawi Refugee Response Plan n’a couvert qu’environ 34 % des besoins, avec pour corollaires l’aggravation de la malnutrition (13,6 %), de l’anémie (jusqu’à 69 % chez les femmes en âge de procréer et 65 % chez les enfants) et d’une insécurité alimentaire touchant près de 80 % des ménages . Les systèmes de santé et d’éducation, insuffisamment dotés, peinent à satisfaire les besoins essentiels, tandis que des conditions climatiques extrêmes accentuent la vulnérabilité des femmes et des enfants. La persistance de ce déplacement forcé soulève de graves préoccupations quant au respect des droits fondamentaux - dignité, santé, éducation et niveau de vie suffisant- tels que garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la Convention de l’OUA de 1969 relative aux réfugiés. La Commission appelle les États membres et la communauté internationale à intensifier leurs efforts en vue de solutions durables et justes, fondées sur la dignité humaine, la solidarité et le partage des responsabilités, afin d’assurer une protection effective et de mettre un terme à cette situation prolongée.
47. Ces évolutions confirment la vulnérabilité persistante des réfugiés et demandeurs d’asile sur le continent et l’urgence de renforcer la solidarité internationale, conformément aux principes de partage des responsabilités et aux obligations consacrées par la Convention de 1951 et la Convention de l’OUA de 1969 sur les réfugiés, ainsi que dans le Pacte mondial sur les réfugiés de 2018.
2) Migrants
48. Lors de la présente période d’intersession, la situation des personnes migrantes en Afrique demeure particulièrement préoccupante. Les tendances observées révèlent une poursuite et une intensification des politiques d’externalisation migratoire, notamment avec l’Union européenne et certains pays européens, une multiplication des accords bilatéraux en matière de migration conclus entre certains États africains et leurs partenaires extérieurs, particulièrement les Etats Unis d’Amérique, ainsi qu’une aggravation des violations des droits fondamentaux des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés et la multiplication des cas de maltraitance et de détentions arbitraires, notamment dans certains pays de transit. Enfin, cette période d’intersession a été marquée par de nombreux naufrages et disparitions de migrants en particulier sur les routes maritimes vers l’Europe , confirmant le caractère toujours meurtrier de la migration irrégulière.
49. Ces évolutions appellent une fois de plus une évaluation rigoureuse des pratiques étatiques à la lumière des obligations internationales et régionales, ainsi qu’un renforcement des mécanismes de contrôle et de redevabilité pour garantir la primauté des droits humains dans la gouvernance migratoire sur le continent.
a) L’Externalisation de la gestion migratoire
50. La coopération migratoire externalisée entre pays africains et partenaires extérieurs s’est renforcée en 2025. L’Union européenne , dans le sillage de son Pacte sur la migration et l’asile, certains Etats européens et les États‑Unis d’Amérique promeuvent des accords bilatéraux visant l’accueil, la rétention temporaire ou le transfert de personnes migrantes vers des États africains, souvent sans garanties suffisantes de transparence et de conformité aux normes internationales relatives aux droits humains. C’est ainsi que l’Union européenne fournit aux États africains des fonds et du matériel et leur permet de renforcer leurs capacités, et plus largement, de bénéficier d’avantages. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) aide les États africains à empêcher les migrants d’arriver dans l’Union européenne, en les interceptant souvent en mer ou en effectuant des pullback .
51. Sur un autre registre, en août 2025, le Rwanda a reçu un premier groupe de sept migrants irréguliers de différentes nationalités expulsés des États‑Unis dans le cadre d’un accord prévoyant l’accueil de jusqu’à 250 personnes .
52. Au Ghana, quatorze ressortissants ouest‑africains expulsés des États‑Unis -dont des Nigérians et un Gambien- ont été placés en détention militaire, puis, pour certains, renvoyés vers le Togo à la suite de démarches judiciaires intentées par leur conseil .
53. En Eswatini, un accord a été conclu avec les Etats Unis permettant l’expulsion de personnes originaires de pays tiers (Vietnam, Jamaïque, Laos, Cuba, Yémen…). Le Gouvernement a officiellement confirmé que plusieurs ressortissants sont déjà arrivés et d’autres sont en cours pour le mois d’octobre, et qu’ils sont/seront détenus en attendant leur du rapatriement .
54. Parallèlement, en Mauritanie, des analyses et enquêtes ont documenté le renforcement des contrôles, interceptions en mer et transferts forcés, dans un contexte de coopération sécuritaire et financière avec l’Union européenne .
55. Le Soudan du Sud a également annoncé officiellement la réception de plusieurs migrants de pays tiers expulsés des Etats Unis dans le cadre des relations de coopération .
56. Plusieurs organisations et mécanismes indépendants ont condamné ces accords d’externalisation. Le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme alerte sur les risques systémiques pour les droits fondamentaux et rappelle que les obligations des États demeurent engageantes même lorsqu’ils agissent par intermédiaire d’États tiers ou d’acteurs privés . Des organisations spécialisées, dont le Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), ont démontré que les accords UE–Tunisie, UE–Égypte accroissent la vulnérabilité des migrants et conditionnent des financements à des pratiques de contrôle qui exposent au risque de violations graves (refoulements sommaires, violences, absence de voies de recours effectives) . Human Rights Watch a par ailleurs documenté, en Mauritanie (2020–début 2025), des violations graves commises par les forces de sécurité à l’encontre de migrants et demandeurs d’asile, dans un contexte de politiques de contrôle externalisées .
b) Migrants disparus
57. Au cours des derniers mois, plusieurs événements dramatiques confirment l’ampleur de la question des migrants disparus. En juin 2025, un navire parti de Tunisie vers Lampedusa a sombré : une femme est morte et deux passagers ont été portés disparus . En août 2025, au moins 26 migrants sont décédés dans un naufrage au large de Lampedusa, des centaines d’autres étant présumés disparus . Plus récemment, sur les côtes libyennes, 61 corps de migrants ont été récupérés à l’ouest de Tripoli au cours d’une même période, sans que les circonstances exactes soient établies .
58. Depuis le début de l’année 2025, au moins 743 personnes ont trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Europe, dont 538 sur la seule route de la Méditerranée centrale. Selon l’OIM, cette route migratoire reste la plus meurtrière au monde, marquée par des pratiques de contrebande de plus en plus dangereuses, des capacités de sauvetage limitées et des restrictions croissantes sur les opérations humanitaires.
59. La route de l’est vers les pays du Golfe à partir de la Corne de l’Afrique a également eu son lot de drames durant cette période d’intersession puisque 56 morts et 132 migrants portés disparus ont été recensés dans un naufrage au large du Yémen .
60. Ces cas s’inscrivent dans les tragédies documentées par le projet Missing Migrants de l’OIM, qui compile les décès et disparitions liées aux migrations internationales . Il est essentiel de rappeler que la résolution CADHP/Res. 486 (2021) de la Commission africaine consacre la responsabilité des États parties : elle condamne les violations pouvant conduire à la disparition de migrants et réfugiés, et appelle les États à adopter des mesures de prévention, de recherche, d’identification et de soutien aux familles des disparus offrant un fondement juridique solide pour exiger davantage de transparence, de solidarité et de mécanismes efficaces de redevabilité face au phénomène tragique des migrants disparus.
61. Nous appelons les Etats Parties à la Charte ainsi que l’Union africaine à intensifier leurs efforts visant à la lutte contre la migration irrégulière en s’attaquant à ses causes profondes, particulièrement : le chômage des jeunes, les conflits armés, la dégradation de la situation socio-économique et politique, le changement climatique… en développant des voies régulières pour une migration légale, et en oeuvrant à ce que les politiques et les pratiques de gestion des migrations soient fondées sur le respect des droits humains de tous les migrants.
c) Violences à l’encontre des migrants
62. Durant cette période d’intersession, des incidents graves en mer à l’encontre des migrants ont été signalés : des tirs attribués aux garde‑côtes libyens auraient visé le navire humanitaire Ocean Viking en août dernier . Des témoignages signalent également des violences, des détentions arbitraires et des transferts vers des centres non officiels.
63. En Mauritanie, des organisations ont dénoncé des rafles, contrôles discriminatoires notamment des contrôles au faciès et non-respect des droits des migrants réclamant des enquêtes indépendantes et la fin des pratiques contraires au principe de non‑discrimination .
3) Déplacés internes
64. Durant cette période d’intersession, la situation des personnes déplacées internes demeure particulièrement préoccupante sur le continent. Dans plusieurs régions, les conflits armés, l’insécurité croissante et les catastrophes naturelles liées au changement climatique continuent de provoquer des déplacements massifs, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante.
A) Conflits et déplacements forcés
65. En République démocratique du Congo (RDC), plus de 80 000 personnes ont fui les violences dans l’est du pays à la suite d’une dégradation majeure de la sécurité dans le territoire de Djugu, en Ituri. Entre le 11 et le 13 août, une série d’attaques menées par des groupes armés dans plusieurs villages - notamment à Iga Barrière - a fait 7 morts parmi les civils et 13 blessés . Ces attaques ont touché les sites de déplacés internes de Lindji, Iga 1 et Mudhu, entraînant le pillage et l’incendie de plusieurs centaines de maisons .
66. Au Burkina Faso, les violences attribuées à des groupes djihadistes ont provoqué le déplacement de près de 230 000 personnes depuis le début de l’année. La région de la Boucle du Mouhoun est la plus affectée, avec plus de 106 000 déplacés - dont plus de 65 000 enfants - répartis dans 13 localités (notamment Dédougou, Di et Tougan). Cela représente 45 % du nombre total de déplacés internes. La dégradation de la sécurité entrave les opérations humanitaires, limite l’accès aux services essentiels et accroît les besoins d’assistance des populations .
67. Au Soudan du Sud, l’instabilité politique et la reprise des affrontements, notamment dans l’État du Haut‑Nil, ont provoqué de nouveaux déplacements massifs . Près de 165 000 personnes déplacées internes ont fui les combats et la dégradation des conditions de vie. L’accès humanitaire demeure restreint dans plusieurs zones, compromettant l’assistance à environ 65 000 personnes nouvellement déplacées. Les taux de malnutrition y restent élevés : 3,2 millions d’enfants et de femmes sont exposés à un risque de malnutrition, soit une hausse de 28 % par rapport à 2024 selon le Programme alimentaire mondial .
68. En Somalie, les violences persistantes ont entraîné le déplacement de plus de 15 000 personnes dans le sud‑ouest, s’ajoutant aux 100 000 déplacés recensés au cours des deux derniers mois dans le centre et le sud du pays. Les familles nouvellement déplacées trouvent refuge dans des sites surpeuplés, souvent sans accès adéquat à un logement digne, à la nourriture ou aux soins essentiels .
B) Changement climatique et déplacements forcés
69. Le changement climatique agit comme un facteur multiplicateur de vulnérabilités et intensifie les crises de déplacement.
70. Au Nigeria, des inondations à Mokwa (centre‑nord) ont déplacé plus de 3 000 personnes — dont 1 600 enfants et 380 mères allaitantes .
71. Au Soudan du Sud, des inondations meurtrières dans l’État d’Unity ont englouti habitations, écoles, infrastructures sanitaires et terres agricoles, affectant plus de 220 000 personnes ; 70 % des terres y étaient déjà submergées par de précédentes crues, et jusqu’à 400 000 personnes supplémentaires pourraient être déplacées d’ici la fin de l’année si les précipitations se maintiennent .
72. Au Niger, les intempéries ont fait plus de 56 000 sinistrés, touchant 78 des 265 communes du pays et obligeant des centaines de familles à se déplacer .
73. Enfin, en Somalie, près de la moitié de la population est affectée par les catastrophes climatiques, l’OIM soulignant un cycle de déplacements répétés qui met à rude épreuve les ressources et alimente les tensions entre communautés .
V. SITUATION DES DROITS DE L’HOMME DANS LES ETATS SOUS RESPONSABILITE
1) Libye
74. Durant cette période d’intersession, la Libye a continué de subir les effets des divisions et fragmentations institutionnelles et politiques , et les conditions de sécurité ainsi que la situation économique sont restées instables avec des répercussions néfastes sur les droits humains et le règne de l’impunité. Toutefois, la MANUL (Mission d’appui des Nations Unies en Libye) a lancé une Feuille de route visant à faire progresser un processus politique dirigé et contrôlé par les Libyens. La feuille de route vise notamment à mettre fin à la période de transition, à faire progresser l’accord sur des institutions unifiées, à amener le pays à des élections présidentielles et parlementaires libres, régulières, transparentes et inclusives, conformément à la résolution 2755 (2024) du Conseil de sécurité, selon un échéancier de 18 mois, et, parallèlement, à organiser un dialogue structuré avec les parties prenantes institutionnelles libyennes et le peuple libyen . Des élections municipales ont été tenues dans 34 municipalités libyennes le 16 et 23 août 2025, tandis que d’autres ont été suspendues dans un certain nombre de municipalités .
75. Nous encourageons tous les acteurs libyens à progresser dans l’instauration d’une paix, d’une stabilité et d’une sécurité durables pour le peuple libyen dans le respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale de la Libye.
76. Sur le plan sécuritaire, cette période d’intersession a connu notamment une détérioration de la situation en matière de sécurité à Tripoli à la suite de l’assassinat, le 12 mai, du chef de l’Organisme d’appui à la stabilité. Les affrontements armés et les manifestations qui ont suivi ont fait plusieurs victimes civiles, des arrestations et endommagé des infrastructures civiles.
77. Sur le plan humanitaire et des droits de l’homme, la situation est aussi préoccupante et de nombreuses allégations concernent encore des violations des droits humains relatives à des exécutions extra-judiciaires, des disparitions forcées, des arrestations et détentions arbitraires sans garanties de procédures, des cas de tortures et de mauvais traitements . À la suite des violences à Tripoli, plusieurs fosses communes et dépouilles ont été découvertes et signalées au parc zoologique d’Abou Salim (site associé à un lieu de détention non officiel de l’Organisme d’appui à la stabilité) ou encore à l’hôpital Al Khadra et à l’hôpital d’Abou Salim. Une fosse commune de 30 corps non identifiés a été découverte sur les côtes de Misrata .
78. S’agissant des migrants et des réfugiés, la Libye reste à la fois une destination majeure et un pays de transit pour d'importants flux migratoires mixtes, comprenant des réfugiés et des migrants. Cela s'explique en grande partie par sa situation géographique stratégique et la porosité de ses frontières terrestres avec les pays voisins. On estime à près d’1 million le nombre de migrants de 44 nationalités résidant en Libye, selon la Matrice de suivi des déplacements de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) .
79. En dépit des efforts déployés par les autorités libyennes et leur volonté de promouvoir une approche pour une gouvernance des migrations basée sur les droits de l’homme et la gestion de la migration irrégulière, les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile continuent d’affronter de nombreux défis à cause d’un accès assez restreint à leurs droits humains, - plus particulièrement en raison de l’augmentation de leur nombre depuis le début du conflit au Soudan en avril 2023 -, ou des nombreuses violations subies dont l’exploitation sexuelles et économique. Durant cette période d’intersession, des milliers de migrants et réfugiés ont été interceptés par les gardes frontières libyens aux frontières terrestres ou alors qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée depuis la côte libyenne, avec des allégations de violence à leur encontre . Des centaines sont morts et d’autres sont portés disparus à cause notamment des conditions souvent extrêmes des routes migratoires via des points de passage irréguliers. Les personnes interceptées auraient été transférées vers des installations où elles seraient arbitrairement détenues.
80. En matière de bonnes pratiques, la Libye a enregistré de nombreuses avancées :
- l’installation / formation par le Conseil présidentiel de deux comités, composés de parties clés, pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité et de droits de l'homme. Ces efforts visent à renforcer les dispositions en matière de sécurité afin de prévenir l'éclatement des combats et d'assurer la protection des civils, tout en répondant aux préoccupations en matière de droits de l'homme dans les centres de détention, ainsi qu'à la prévalence des détentions arbitraires. Ces comités interviennent à un moment critique où les Libyens exigent des réformes sérieuses et des institutions étatiques responsables et démocratiques.
- le consensus obtenu sur les éléments clés d'un projet de loi sur les personnes disparues lors d'une réunion qui s'est tenue à Tripoli les 17 et 18 septembre dans le cadre d'une initiative conjointe de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) intitulée « Traiter le dossier des personnes disparues en Libye », au cours de laquelle, les participants ont convenu de la nécessité de créer une commission nationale unifiée sur les personnes disparues, dotée d'un mandat clair afin d'éviter les doublons entre les institutions existantes. Ils ont insisté sur la nécessité d'aligner la loi sur les normes internationales en matière de disparitions forcées, de renforcer la protection des familles et de lier la recherche des personnes disparues à la justice transitionnelle . Il s'agit d'une avancée importante vers la garantie des droits des personnes disparues et de leurs familles.
-Enfin, Le 12 mai, la Libye, dans une déclaration déposée au Greffe de la Cour pénale internationale au titre de l’article 12 (3) du Statut de Rome, a accepté la compétence de la Cour pour connaître des crimes présumés commis sur son territoire entre 2011 et 2027.
81. Nous encourageons le Gouvernement libyen à poursuivre ses efforts pour améliorer la situation des droits de l’homme en Libye.
2) Niger
82. Durant cette période d’intersession, le Niger continue d’être confronté à des défis importants en raison de l'instabilité régionale provenant des pays voisins tels que le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria, ainsi que des activités des groupes armés et de la criminalité transfrontalière notamment dans les régions de Tillabéri, Maradi, Diffa et Tahoua où la situation sécuritaire demeure préoccupante . A Tillabéri, des attaques attribuées à l’État islamique au Sahel ont entraîné des pertes parmi les Forces de défense et de sécurité ainsi qu’au sein des populations civiles. Des allégations font également état d’insuffisances de protection en amont de certaines attaques et d’incidents liés à des opérations des forces nationales : ainsi, le 22 septembre, un raid aérien mené à Injar (Kourfeye) dans la poursuite de groupes armés aurait causé plusieurs victimes civiles. D’autres rapports évoquent le décès de centaines de civils tués dans la région de Tillabéri, notamment lors de frappes de drones sur des marchés, des sites d’orpaillage et des transports en commun .
83. Sur le plan des droits et des libertés, cette période a été marquée par la dissolution de quatre syndicats de magistrats , décidée par les autorités au motif qu’ils n’auraient pas œuvré au bon fonctionnement du service public de la justice . Cette mesure, adoptée dans un contexte de crise structurelle du secteur (insuffisance de moyens, dysfonctionnements persistants), soulève des préoccupations au regard de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de la liberté d’association garanties par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Commission rappelle que toute restriction à ces droits doit respecter les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité et invite l’État à privilégier le dialogue institutionnel et les voies disciplinaires prévues par la loi.
84. La situation de nombreux défenseurs des droits de l’homme, à l’instar de Moussa Tchangari est également préoccupant suite à de nombreuses allégations sur des arrestations et des détentions arbitraires, ainsi que des restrictions des activités de certaines ONG humanitaires et la dissolution d’autres impactant l’aide et l’assistance humanitaire dont dépendent de nombreuses personnes eu égard aux défis auxquels le Niger est confronté sur ce plan. Nous invitons les autorités nigériennes, à permettre, dans le respect des lois nationales, à ces ONG de continuer librement leur travail humanitaire.
85. En guise de bonnes pratiques, il est important de souligner que le Niger, avec l’appui du HCR, a lancé l’Alliance mondiale pour mettre fin à l’apatridie (oct. 2024, opérationnalisée en aout 2025 à Diffa) pour accélérer les réformes nationales, élargir l’accès à l’état civil et à la nationalité et renforcer la coordination institutionnelle (État–société civile–partenaires). Des groupes de travail “apatridie” sont actifs dans six régions, rapprochant les services des communautés .
3) Sénégal
85. Au cours de la période considérée, il est à souligner les informations relatives à une accumulation de poursuites pour délits d’opinion, notamment la condamnation du journaliste Doudou Coulibaly pour des accusations d’offense à un chef d’État étranger , l’incarcération de plusieurs chroniqueurs et la multiplication des convocations d’opposants par les services de police . Ces développements font craindre une régression de la liberté d’expression et de la presse, garanties par la Constitution et par l’article 9 de la Charte africaine. La Commission rappelle que toute restriction à la liberté d’expression doit répondre aux critères de légalité, nécessité et proportionnalité, et invite les autorités sénégalaises à privilégier des réponses compatibles avec les normes régionales et internationales en matière de protection des journalistes et des défenseurs des droits humains.
86. Parallèlement, la Commission note avec satisfaction l’adoption de quatre lois structurantes visant à renforcer la transparence, l’intégrité publique et la redevabilité : (i) protection des lanceurs d’alerte ; (ii) réforme de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) ; (iii) accès à l’information ; et (iv) déclaration de patrimoine . Ces textes constituent une avancée normative significative et offrent un cadre accru pour la prévention, la détection et la sanction de la corruption. Nous encourageons leur mise en œuvre effective, l’allocation de ressources adéquates aux institutions compétentes et l’instauration de mécanismes indépendants de suivi associant la société civile et toutes les autres parties prenantes.
4) Tunisie
87. Cette période d’intersession a été marquée par la dissolution de l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI) en août 2025 , mesure pouvant être perçue comme une atteinte à un acquis majeur de la révolution de 2011. Créée par la loi organique de mars 2016, cette instance indépendante permettait aux citoyens et aux journalistes d’obtenir des informations auprès des institutions publiques. Sa suppression risque de restreindre la liberté d’expression et la transparence administrative, garanties par la Constitution tunisienne et par l’article 9 de la Charte africaine.
88. La Commission invite le Gouvernement tunisien d’envisager de restaurer des mécanismes indépendants d’accès à l’information, gages de bonne gouvernance et de redevabilité publique, et à s’abstenir de toute mesure susceptible d’affaiblir les institutions garantes des libertés fondamentales.
89. Sur un autre registre, l’arrestation et la détention arbitraires du juge Mourad Messaoudi , posent de sérieuses inquiétudes quant à l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’immunité judiciaire, garantis par la Constitution tunisienne et de nombreuses dispositions de la Charte africaine. Nous invitons le Gouvernement tunisien à veiller à ce que tous les actes répréhensibles présumés commis par des membres du pouvoir judiciaire fassent l’objet d’une enquête et de poursuites, lorsque les preuves le justifient, conformément à la loi, y compris dans le plein respect de l’immunité judiciaire et à rétablir un Conseil supérieur de la magistrature indépendant chargé de la discipline et de la révocation des juges et des procureurs.
90. Par ailleurs, la question migratoire demeure préoccupante en Tunisie comme dans une grande partie du Continent. S’il est bon de souligner les efforts engagés par le Gouvernement tunisien dans la campagne des opérations de retour volontaire et de réintégration, étant donné que le bureau tunisien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a facilité, en août 2025, le retour volontaire de 268 ressortissants guinéens , les pratiques de refoulements et d’expulsions collectives sont toujours pratiquées -même si elles ont diminué. Tout en saluant ces efforts, nous invitons les autorités tunisiennes à garantir que les opérations de retour, de contrôle migratoire ou de démantèlement des camps informels soient menées dans le respect des normes internationales et régionales de protection des droits de l’homme, en veillant particulièrement à la dignité, à la sécurité et à l’accès aux soins des migrants, notamment des femmes et des enfants. Nous invitons également les autorités tunisiennes à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux expulsions collectives et protéger les droits de l'homme de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, en assurant le respect à leur dignité humaine.
91. En guise de bonne pratique également, nous saluons l’adoption de la loi n° 2025-09 du 21 mai 2025, portant organisation des contrats de travail et interdiction de la sous-traitance, qui est globalement conforme aux instruments des droits de l'homme en cherchant à renforcer la protection et la stabilité des travailleurs, notamment en consacrant le CDI comme principe général, en interdisant la sous-traitance de main-d'œuvre, et en assurant un meilleur accès aux droits sociaux.
VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.
92. Je souhaite réitérer les recommandations formulées dans les précédents rapports dont certaines sont toujours d’actualité, et auxquelles s’ajoutent de nouvelles, notamment :
a) A l’endroit des Etats Parties à la Charte africaine :
- S’approprier et mettre en œuvre les Principes directeurs africains relatifs aux droits de l'homme de tous les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, adoptés en 2023 par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ;
- S’approprier la Résolution CADHP/RES. 486 (EXT.OS/ XXXI1I) 2021 sur les migrants et Réfugiés disparus en Afrique et les conséquences sur leurs familles, et la Résolution CADHP/Res.565 (LXXVI) 2023 sur l'inclusion des réfugiés, des demandeurs d'asile, des déplacés internes et des apatrides dans les systèmes socio-économiques nationaux, les services et les opportunités économiques en Afrique ;
- S’assurer que les réfugiés puissent jouir de l’ensemble de leurs droits humains, notamment leurs droits économiques et sociaux et certaines libertés dans le cadre des lois nationales ;
- Respecter les principes des Conventions de Genève et de l’OUA sur la protection des réfugiés qui consacrent le principe fondamental de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives ;
- Ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux aspects spécifiques au droit à la nationalité et l’éradication de l’apatridie en Afrique, afin de permettre son entrée en vigueur le plus tôt possible ;
- Renforcer l’assistance accordée aux Etats recevant un nombre élevé de demandeurs d’asile ou de réfugiés, sur la base du principe de partage des charges et des responsabilités ;
- Mettre fin à la détention des migrants sur la simple base de leur statut migratoire, et la remplacer, à chaque fois que c’est possible, par des alternatives à la détention, plus humaines et plus respectueuses de la dignité des migrants.
- Répondre positivement aux demandes de la Commission relatives à l’autorisation de missions de promotion.
b) A tous les Etats membres de l’Union africaine :
- Ratifier le Protocole au Traité instituant la Communauté Economique Africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit d’établissement ;
- Pour ceux ne l’ayant pas encore fait, ratifier la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969) ; et pour ceux l’ayant fait, en assurer la mise en œuvre ;
- Appliquer les objectifs consacrés dans les Pacte mondial sur les réfugiés de 2018 ;
- S’impliquer davantage dans la prévention des déplacements forcés des populations à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs pays, quelle que soit la cause du déplacement (conflits armés, changements climatiques, grands projets de développement, catastrophes naturelles, etc.) et assurer une protection aux personnes lorsque la prévention a échoué ;
- Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, accélérer le processus de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) ; et pour ceux qui l’ont ratifiée, en opérationnaliser les dispositions à travers des politiques et des programmes en faveur des personnes déplacées internes et en faire état à la Commission dans leurs rapports périodiques conformément à l’article 14 alinéa 4 de la Convention ;
- S’engager dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (2018) ;
- Travailler à la prise de mesures concrètes en vue de répondre efficacement aux défis que soulèvent l’impact du changement climatique sur les déplacements forcés des populations sur notre continent ;
- Prendre des mesures pour s’assurer que les crimes à caractère xénophobe et raciste contre les réfugiés, les migrants et les demandeurs d’asile soient effectivement sanctionnés et accorder aux victimes des voies de recours.
c) A l’Union Africaine, nous recommandons :
- D’encourager les Etats à ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples sur les aspects spécifiques du droit à la nationalité et l’éradication de l’apatridie en Afrique ;
- D’engager les Etats à la résolution pérenne des conflits existants afin d’enrayer les causes des déplacements forcés pourvoyeurs de réfugiés, déplacés internes et migrants ;
- Accélérer l’opérationnalisation de l’Agence Humanitaire africaine en la dotant d’un fond conséquent et de moyens réels d’action pour qu’elle puisse effectivement prendre en charge les différentes situations humanitaires en Afrique
- Adopter, en partenariat avec la Commission et d’autres parties prenantes, des Lignes directrices sur la question des migrants disparus.
d) A l’endroit du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et autres agences onusiennes et organisations internationales, nous recommandons de :
- Travailler avec les Etats africains afin de trouver des solutions durables concernant la situation des réfugiés et demandeurs d’asile ainsi que des déplacés internes, et en particulier les réfugiés de long terme ;
- Augmenter les montants alloués à l’aide humanitaire pour les réfugiés, les demandeurs d’asile, et les déplacés internes ;
- Renforcer la collaboration avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur des thématiques d’intérêt commun ;
- Continuer à nous accompagner dans le plaidoyer sur l’éradication de l’apatridie en Afrique et également la mise en œuvre des recommandations de la résolution CADHP/Res.565 (LXXVI) 2023 sur l'inclusion des réfugiés, des demandeurs d'asile, des déplacés internes et des apatrides dans les systèmes socio-économiques nationaux, les services et les opportunités économiques en Afrique.
e) A l’endroit des acteurs de la Société civile et autres partenaires, nous recommandons de :
- Mettre en place des stratégies et des plans d’actions pour la ratification du Protocole sur la nationalité et l’éradication de l’apatridie en Afrique ;
- Poursuivre le plaidoyer en vue de la ratification universelle de la Convention de Kampala ;
- Continuer leur action sur le terrain pour nous tenir informés sur la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile, des déplacés internes et des migrants et apporter soutien et assistance à la Rapporteure spéciale afin qu’elle puisse s’acquitter convenablement de son mandat ;
- Au CICR, de poursuivre le travail avec les Etats et le mandat sur l’application effective de la Résolution CADHP/RES. 486 (EXT.OS/ XXXI1I) 2021 sur les migrants et Réfugiés disparus en Afrique et les conséquences sur leurs familles.
93. Pour conclure, nous voudrions exprimer nos vifs remerciements à l’endroit de tous les Etats, nos partenaires, particulièrement la Commission de l’Union africaine, le CICR, le HCR et l’OIM, les INDH et toutes les organisations de la société civile pour le soutien constant apporté à notre Mécanisme.
Je vous remercie pour votre aimable attention.