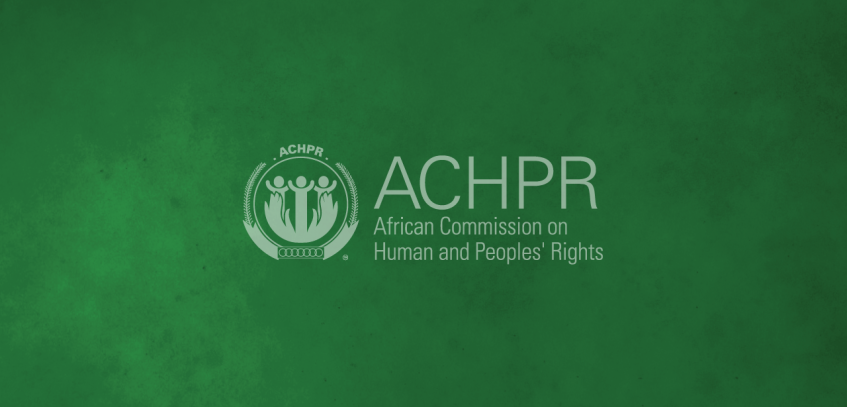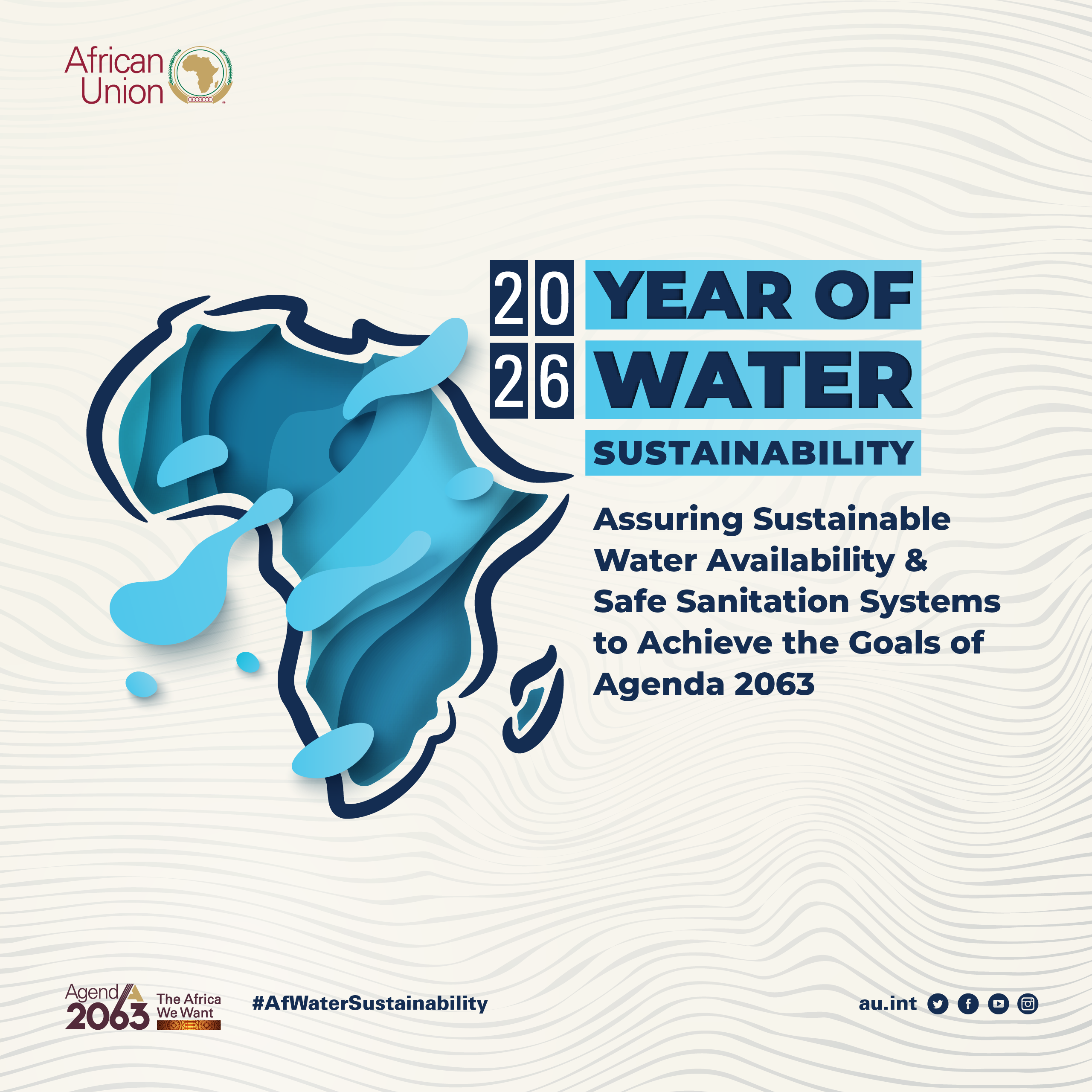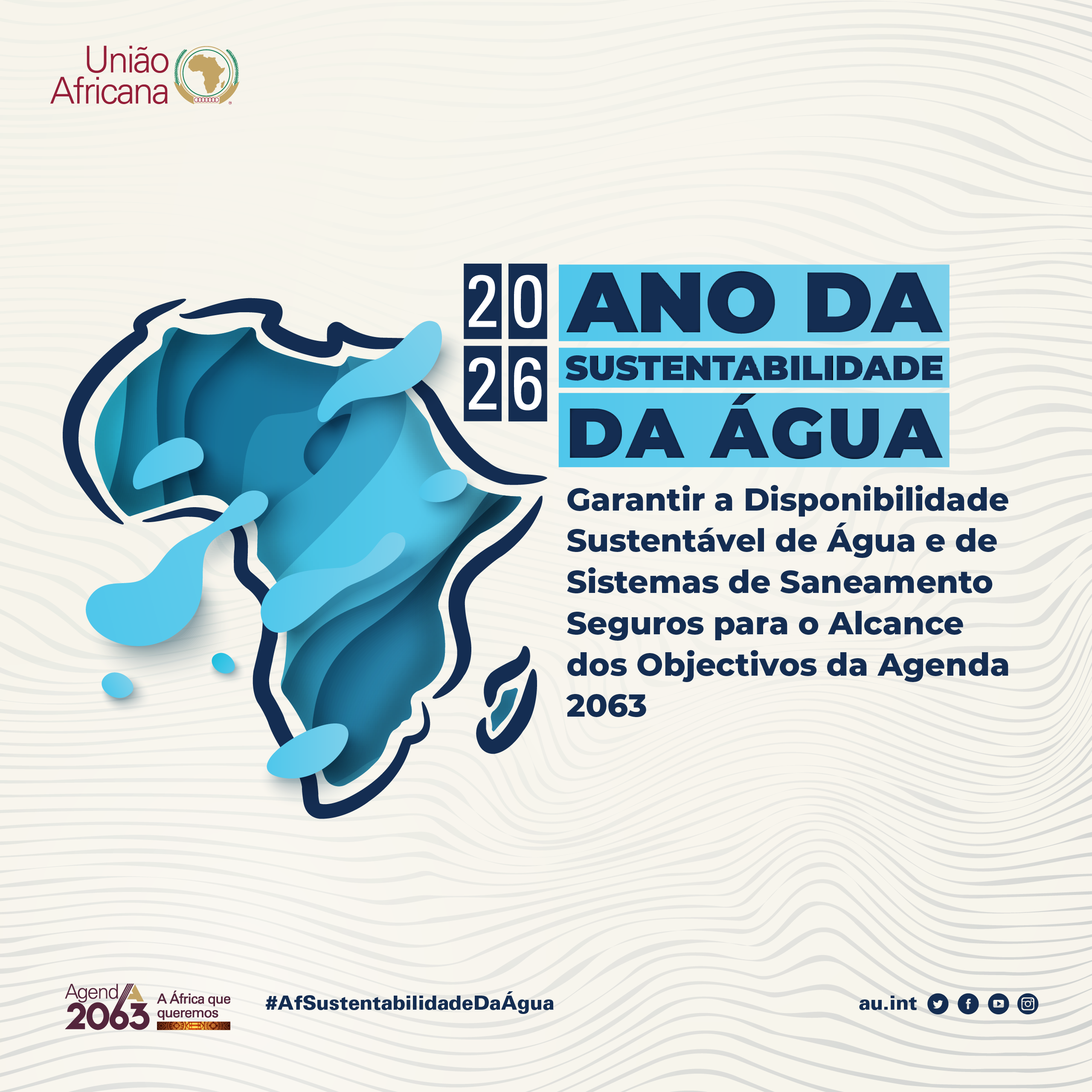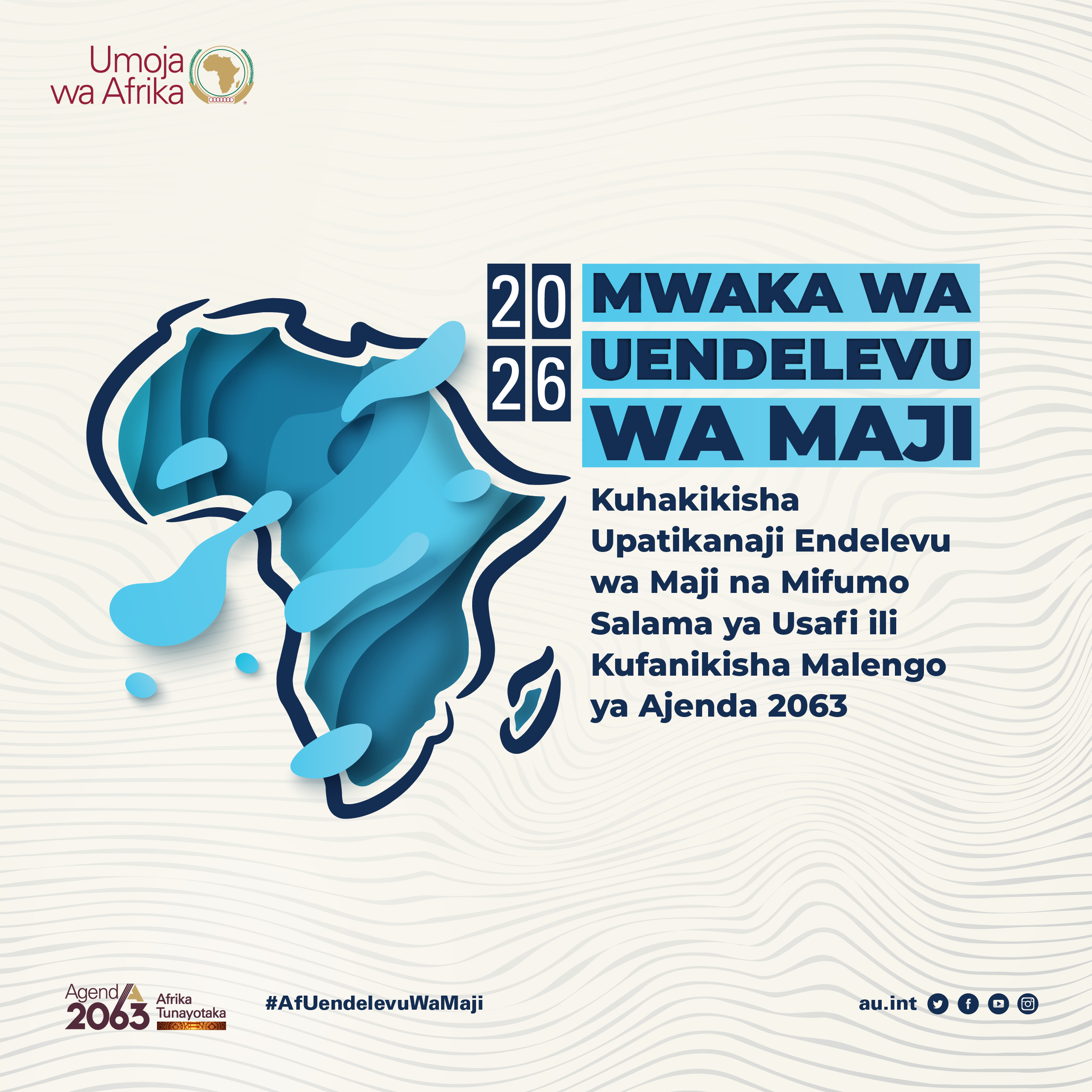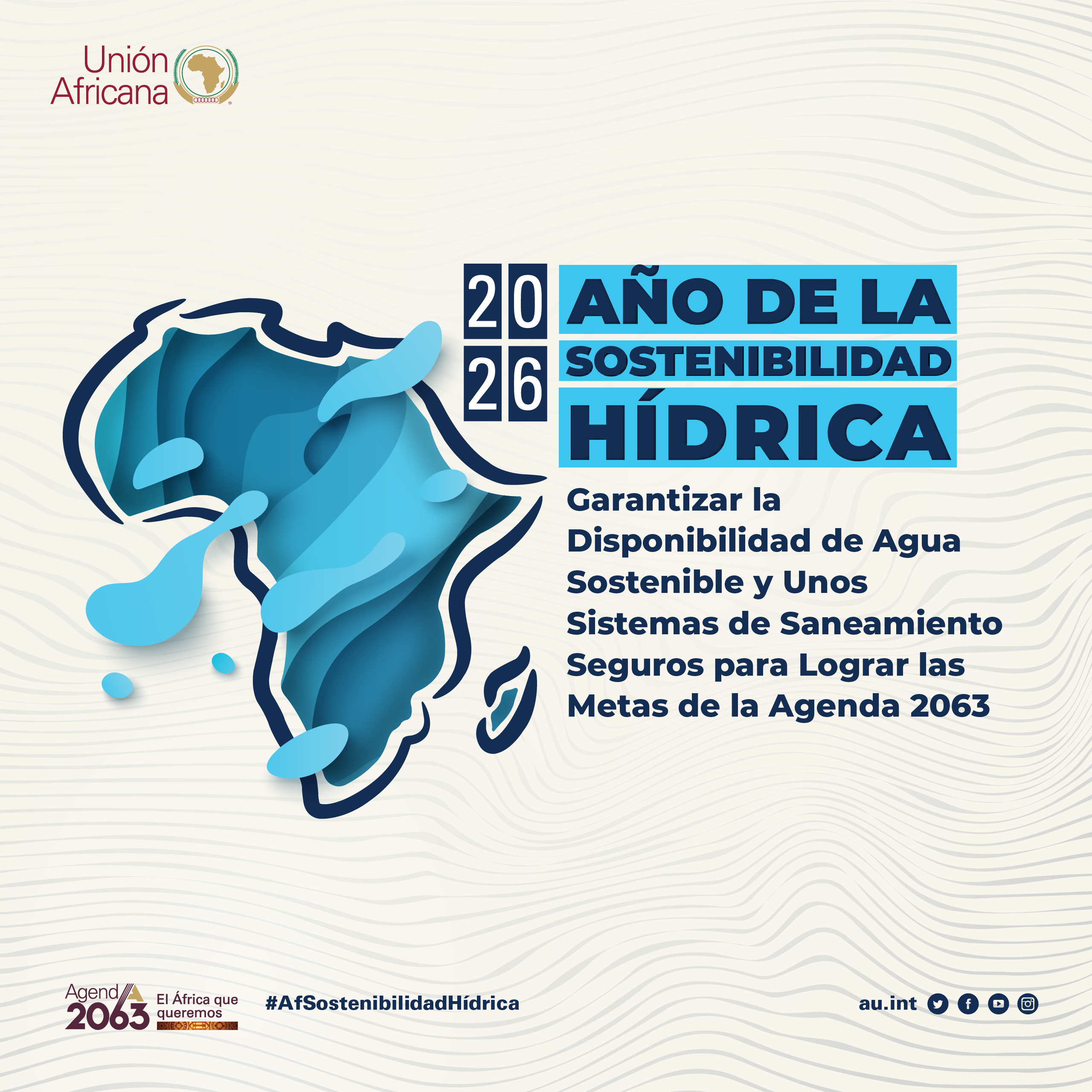Declaration du Reseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l'Homme a l'Occasion de la 47ème Session
Ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
12-26 mai 2010, Banjul, Gambie
Par Laurence MUSHWANA, Vice-présidente du NANHRI Excellence, Monsieur le Représentant de la République de
Gambie,
Excellence, Madame la Présidente de la Commission africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples,
Honorables Commissaires de la Commission africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs du Corps diplomatique accrédité en Gambie,
Chers invités,
Chers Collègues,
C’est pour moi un immense privilège et un honneur de m’adresser à vous, au nom du Réseau des Institutions africaines des Droits de l’Homme, à l’occasion de la 47ème Session ordinaire de la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Permettez-moi de dire ma profonde et sincère gratitude aux
autorités et au peuple de la République de Gambie pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé.
Mesdames, Messieurs, Honorables invités, Chers Collègues,
Je voudrais également dire mon appréciation à la Commission africaine des Droits de l’Homme pour ses efforts louables visant à faire des droits humains une réalité sur le continent et cela malgré les nombreux obstacles auxquels cette initiative est confrontée. Je
reconnais également le courage et la ferveur avec lesquels les défenseurs des droits de l’homme et les INDH en Afrique ont pris des mesures pour améliorer la situation des droits humains sur le continent malgré les difficultés rencontrées.
Cela étant, NANHRI, un organisme de coordination des INDH d’Afrique, note avec préoccupation qu’au cours des dernières années, la situation des Défenseurs des Droits de l’Homme en Afrique s’est considérablement dégradée, notamment du fait de l’instabilité politique et sociale. Différentes parties du continent ont connu l’expérience de la violence intervenant dans le contexte d’élections, de guerres civiles, d’agressions ethniques et xénophobes.
L’engagement dans la promotion et la protection des droits humains dans de tels contextes s’accompagne de risques extrêmement élevés, en particulier lorsque les institutions sont faibles, que la législation est inadaptée et que les mécanismes de protection sont inefficaces. Le rôle important et les efforts des Défenseurs des Droits de l’Homme dans la promotion, la protection et la pleine jouissance des droits humains par tous devraient être reconnus et salués, au lieu d’être diabolisés.
Mesdames, Messieurs, Honorables invités, Chers Collègues,
NANHRI prend note avec préoccupation de la rareté des initiatives nationales pratiques susceptibles d’assurer une protection physique efficace aux défenseurs des droits de l’homme. En conséquence, il est souhaitable et absolument nécessaire de mettre l’accent sur la coopération avec toutes les organisations intergouvernementales régionales des droits humains en vue d’assurer la protection des défenseurs des droits humains. En outre, les Etats africains devraient aussi créer, développer et améliorer des stratégies et
programmes permettant de garantir une protection physique aux défenseurs des droits de l’homme dans leurs pays respectifs. Il s’agit là du premier pas vers l’instauration d’un environnement de travail sûr pour les défenseurs.
Les Etats africains ont le devoir de légiférer pour mettre en place un mécanisme officiel de protection, comme des programmes de protection des témoins. Des programmes de protection devraient être également mis en œuvre dans l’ensemble du pays et couvrir
les défenseurs en situation de risque. Par ailleurs, les Etats africains devraient, en urgence, faire l’évaluation de leur méthodologie afin de garantir une mise en œuvre cohérente au niveau national.
Mesdames, Messieurs, Honorables invités, Chers Collègues,
Même si l’obligation de protéger les défenseurs des droits de l’homme et de garantir leur sécurité incombe, pour l’essentiel, aux Etats, les défenseurs eux-mêmes peuvent aussi prendre des mesuresafin de renforcer leur propre sécurité en se familiarisant avec la Déclaration sur les Défenseurs des Droits de l’Homme, étant donné qu’il apparaît que l’un des facteurs qui contribuent à l’absence d’un environnement sécurisé et propice pour les défenseurs tient à leur méconnaissance de la Déclaration. Par conséquent, il est important de promouvoir la vulgarisation de la Déclaration et de veiller à ce qu’elle devienne un instrument de référence utile.
Le NANHRI appelle les défenseurs à contribuer à l’amélioration de leur propre sécurité de manière systématique. Le NANHRI estime qu’une meilleure connaissance des bonnes pratiques dans le domaine de la protection les encouragerait à remplir leur mandat.
Mesdames, Messieurs, Honorables invités, Chers Collègues,
La présente 47ème Session de la Commission africaine se déroule à un moment où un nombre important de défis se posent sur notre continent du fait des irrégularités électorales. La dernière démarche adoptée pour mettre un terme aux cycles de violence post ou pré- électorale en Afrique consiste à mettre en place des mécanismes de partage du pouvoir et d’union nationale, ou gouvernements de coalition, dont de nombreux exemples existent sur le continent. De nos jours, en l’absence d’un mandat clair en Afrique, les gouvernements de coalition se présentent comme la solution. Ces gouvernements sont créés sur le principe du partage du pouvoir entre le parti au pouvoir et les partis d’opposition, une démarche
qui a pour but essentiel de prévenir les conflits politiques et les perturbations sociales et, en particulier, d’assurer la poursuite des réformes économiques et politiques dans le contexte national général.
Mesdames, Messieurs, Honorables invités, Chers Collègues,
La difficile situation que vivent les femmes et les enfants dans des contextes africains marqués par les conflits armés constitue une autre source de grande préoccupation pour le Réseau des Institutions nationales des Droits de l’Homme du continent
africain. Aujourd’hui, les femmes et les enfants sont beaucoup plus exposés que les combattants armés au risque d’être victimes des conflits armés intervenant en Afrique. Sur le terrain de bataille, les corps des femmes sont devenus des « parties au conflit » pour ceux qui utilisent l’arme de la terre comme tactique guerrière, elles sont violées, enlevées, humiliées et forcées de porter des grossesses, abusées sexuellement et réduites en esclavage.
La protection et le soutien dont bénéficient les femmes ayant survécu à la violence dans les zones de conflit et post-conflit d’Afrique sont très insuffisants. L’accès aux services sociaux, à la protection, aux voies de recours juridiques, aux ressources médicales et aux lieux d’accueil des réfugiés est peu satisfaisant, malgré les vaillants efforts consentis par de nombreuses ONG locales pour apporter leur aide. Le climat d’impunité exacerbe davantage la situation et alimente la violence en cours. La Résolution 1325, adoptée le 31 octobre 2000, par les Nations Unies sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, appelle à une participation égale des femmes à la prise en charge des questions de paix et de sécurité et pourtant, sept ans plus tard, il est évident qu’une intensification des efforts s’impose, si l’on veut renforcer les mécanismes susceptibles de prévenir la violence faite aux femmes en temps de guerre, d’ouvrir des enquêtes à ce sujet, d’en rendre compte, d’ouvrir des poursuites et d’y apporter remède et si l’on veut aussi faire de telle sorte que leurs voix se fassent entendre pendant l’étape de consolidation de la paix.
Mesdames, Messieurs, Honorables invités, Chers Collègues,
Une caractéristique marquante de ces 20 dernières années qui offre une lueur d’espoir au continent tient à l’augmentation constante des Institutions nationales des droits de l’homme (INDH), en particulier dans les démocraties nouvelles et en développement de l’Afrique, et aux activités novatrices de l’ACGPR et d’autres mécanismes régionaux africains des droits humains. Les INDH, qui ont pour mandat de mettre en œuvre des normes internationales des droits humains au niveau national, ont été créées dans les pays du continent. La création de ces institutions a été favorisée par le sentiment, qui s’est imposé de force dans les années 90, que la protection des droits est mieux assurée par l’état de droit démocratique et la démocratie pluraliste et vice versa. Malgré leur relative nouveauté, l’expérience des INDH met en exergue une série de défis liés à la transmission et à la médiation institutionnelles des normes des droits humains au sein des systèmes politiques en voie de démocratisation.
En outre, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 5 octobre 2007, une résolution qui appelle le système des Nations Unies à mettre au point une stratégie cohérente et efficace, notamment par le biais de programmes et d’activités conjoints pour la promotion et la protection des droits humains en Afrique, dans le cadre de la mise en œuvre des traités régionaux et internationaux, des résolutions et plans d’action adoptés par les deux organisations.
Le NANHRI se réjouit de la collaboration actuelle entre l’UA, la CADHP et le HCDH, une démarche diversifiée et satisfaisante qui contribuera grandement à la promotion d’une stratégie des droits humains en Afrique, aussi bien au niveau régional que national.
Le NANHRI soutiendra les INDH existantes et encouragera d’autres nations africaines à créer des institutions similaires, conformément aux critères normatifs internationaux, les Principes de Paris, de telle sorte qu’elles puissent faciliter la mise en œuvre de la stratégie au niveau national.
Je vous remercie de votre aimable attention