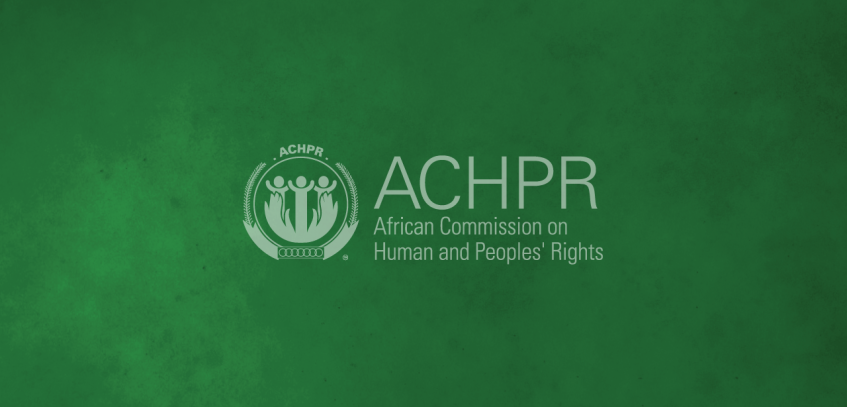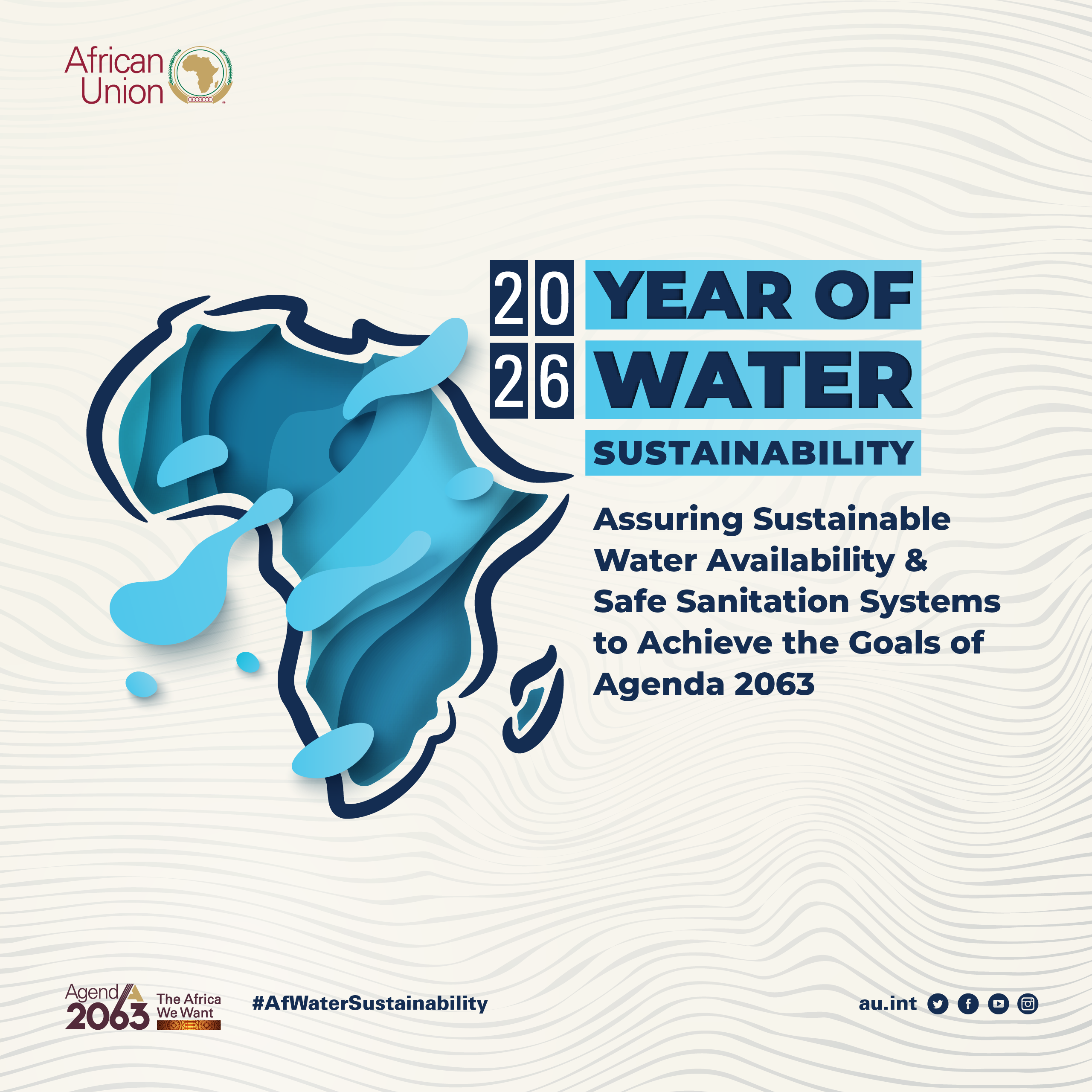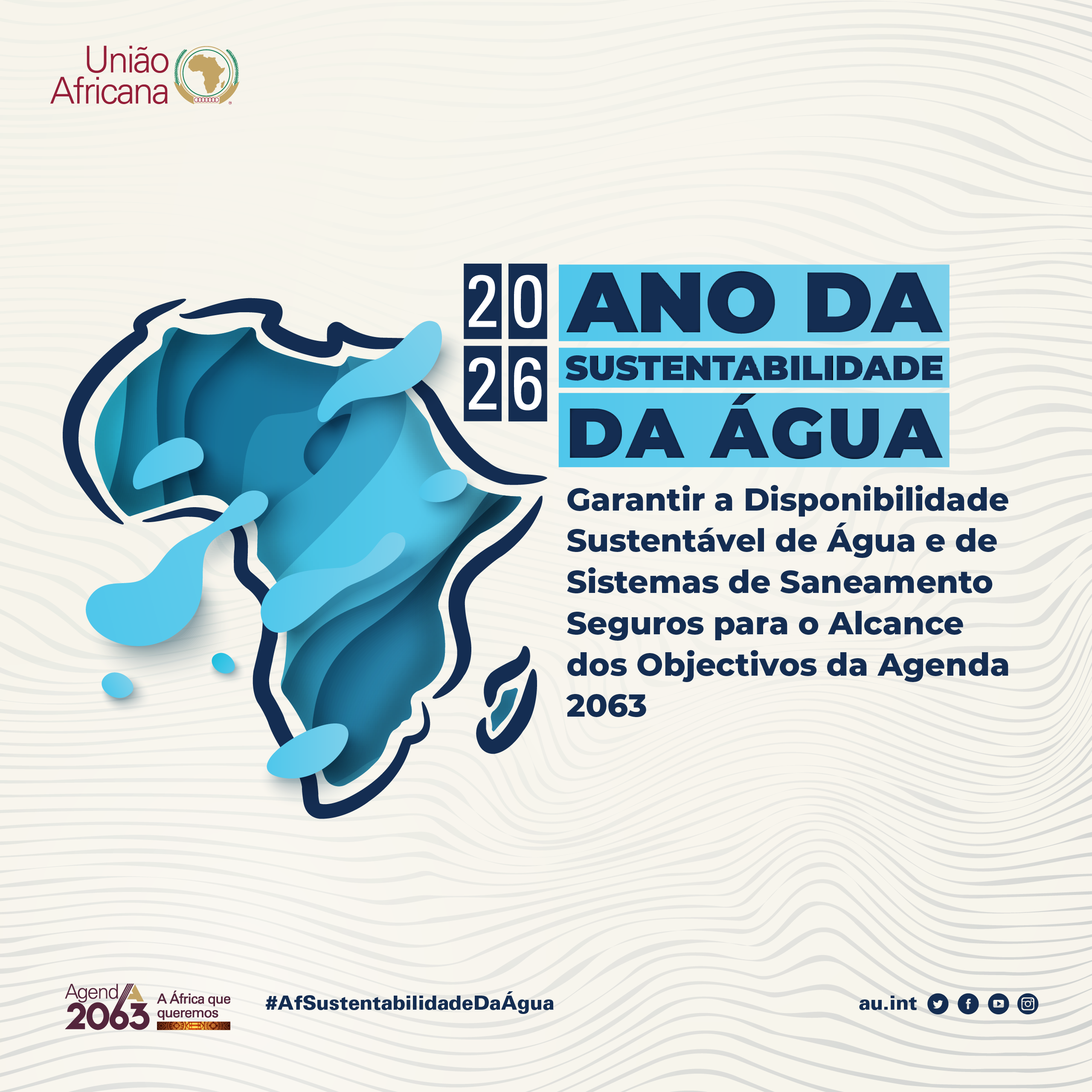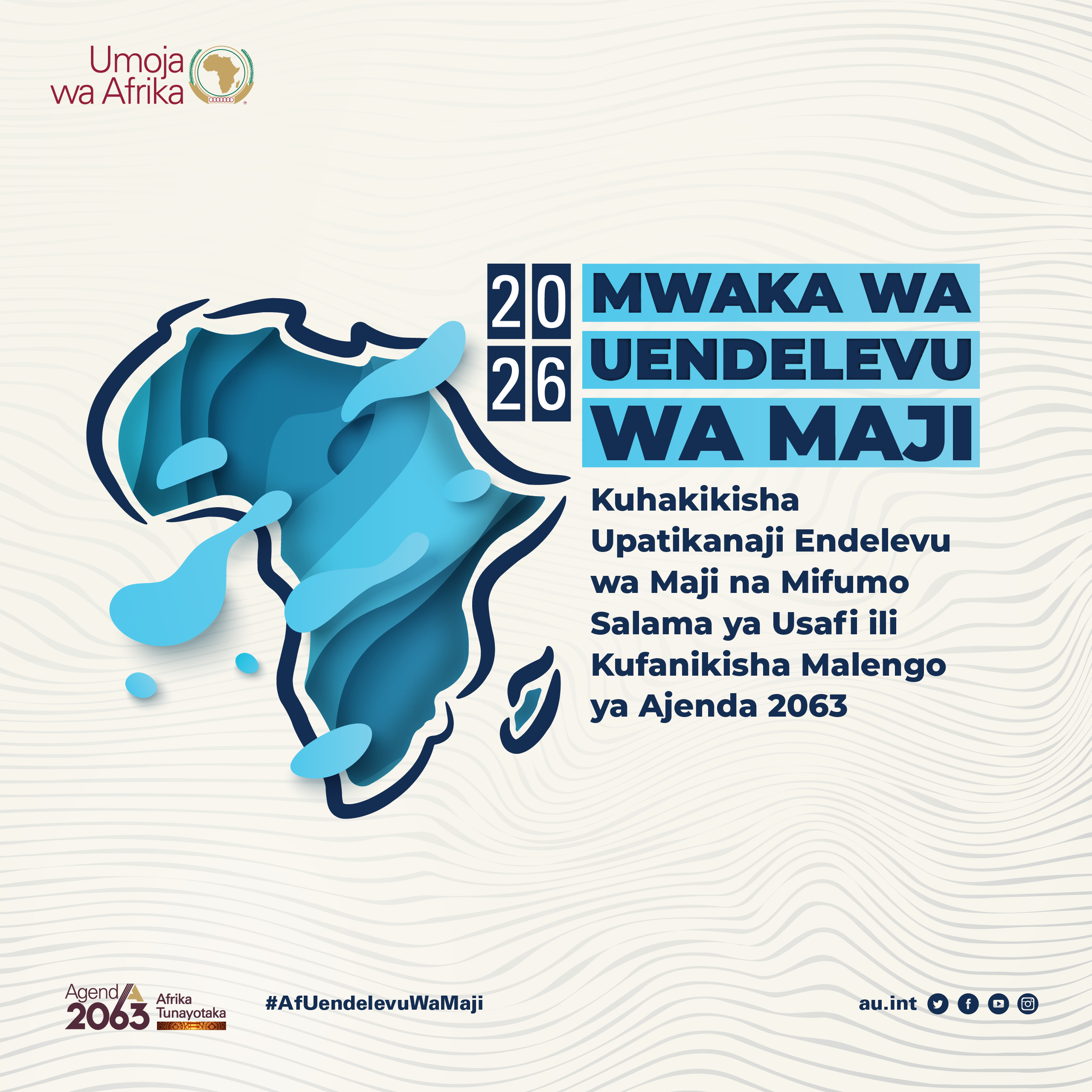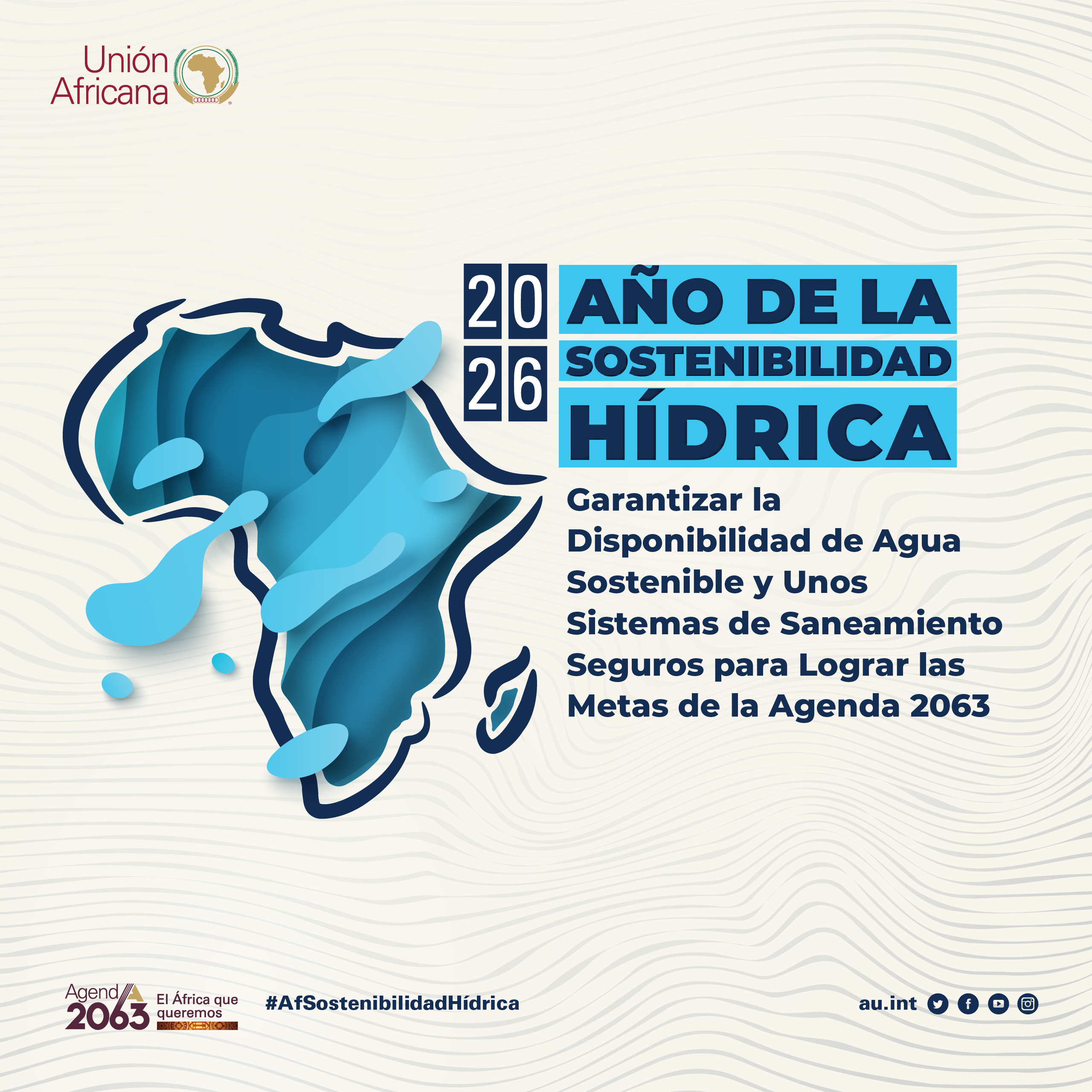Communiqué de presse à l’issue de la Mission de Promotion de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en République du Ghana
Conformément au mandat qui lui est conféré par l’article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine), et suite à l’autorisation accordée par le Gouvernement de la République du Ghana, une délégation de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) a effectué une mission de promotion au Ghana du 29 septembre au 2 octobre 2025.
La délégation de la Commission était composée des personnalités suivantes :
L’Honorable Commissaire Janet Ramatoulie Sallah-Njie, Commissaire chargée de la promotion des droits de l’homme au Ghana et Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique ;
L’Honorable Commissaire Solomon Ayele Dersso, Président du Groupe de travail sur les industries extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme ;
L’Honorable Commissaire Hatem Essaiem, Président du Comité pour la prévention de la torture en Afrique ;
L’Honorable Commissaire Maria Teresa Manuela, Rapporteure spéciale sur les prisons, les conditions de détention et l’action policière en Afrique ;
L’Honorable Commissaire Mudford Zachariah Mwandenga, Président du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels.
La mission a bénéficié du soutien du personnel du Secrétariat de la Commission.
Les objectifs poursuivis par cette mission étaient notamment : Promouvoir la Charte africaine ainsi que les autres instruments régionaux pertinents, et plaider en faveur de la ratification des traités relatifs aux droits de l’homme en attente ; Renforcer la coopération entre la Commission et le Gouvernement du Ghana, tout en accroissant la visibilité de la Commission auprès des institutions nationales et de la société civile ; Engager un dialogue constructif sur les mesures législatives et politiques mises en œuvre pour assurer l’application des dispositions de la Charte africaine ; Encourager la soumission dans les délais de tous les Rapports Périodiques en souffrance conformément à l’article 62 de la Charte africaine, ainsi que du Rapport initial sur la mise en œuvre du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) ; Évaluer l’application du Protocole de Maputo et discuter des stratégies de lutte contre les violences fondées sur le genre, tout en promouvant la participation politique et économique des femmes ; Recueillir des informations sur la situation spécifique des femmes et des filles issues de groupes vulnérables, notamment celles en détention, en situation de handicap ou vivant dans la pauvreté ; Examiner le cadre juridique et institutionnel de prévention de la torture et des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants ; Visiter des lieux de détention afin d’évaluer les conditions de détention et de dialoguer avec les responsables sur les procédures de garde à vue, les mécanismes de reddition de comptes et les services de réinsertion ; Enquêter sur les incidences des activités extractives et industrielles sur les droits humains, notamment en ce qui concerne les droits fonciers, les déplacements de populations, la pollution environnementale et l’accès aux recours pour les communautés affectées.
Au cours de la mission, la délégation a rencontré divers acteurs gouvernementaux, notamment lors de réunions techniques avec les ministères, départements et agences, ainsi qu’avec des organisations de la société civile, des partenaires au développement œuvrant au Ghana, et d’autres intervenants engagés dans la promotion et la protection des droits de l’homme. La mission a débuté par une visite de courtoisie auprès du Vice-Ministre des Affaires étrangères.
Au cours de sa mission, la délégation de la Commission a mené des consultations de haut niveau avec les autorités suivantes :
Son Excellence Monsieur Alban Kingsford Sumana Bagbin, Président du Parlement
Son Excellence Monsieur Samuel Okudzeto Ablakwa, Ministre des Affaires étrangères;
Son Excellence Monsieur Muntaka Mohammed-Mubarak, Ministre de l’Intérieur ;
Son Excellence Madame Agnes Naa Momo Lartey, Ministre du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale ;
Son Excellence Monsieur James Gyakye Quayson, Vice-Ministre des Affaires étrangères ;
Son Excellence Monsieur Srem Sai, Vice-Ministre de la Justice et Procureur Général adjoint ;
Monsieur Joseph Akanjolenur Whittal, Président de la Commission des Droits de l’Homme et de la Justice Administrative.
La délégation a également échangé avec des représentants de ministères, départements et agences clés, notamment :
Le Bureau du Procureur Général et Ministère de la Justice ;
Le Ministère de l’Intérieur ;
Le Ministère du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale ;
Le Ministère du Travail, de l’Emploi et des Affaires sociales ;
Le Ministère de l’Environnement, des Sciences et des Technologies ;
Le Parlement du Ghana.
La Commission des Droits de l’Homme et de la Justice Administrative (CHRAJ) ;
La Commission nationale de planification du développement ;
Le Service de police du Ghana ;
Le Service d’immigration du Ghana.
La délégation a également rencontré des représentants d’organisations de la société civile, parmi lesquelles :
Springboard Road ;
Show Foundation Ghana ;
ABANTU for Development ;
Gender Centre for Empowering Development (GenCED) ;
Human Rights Reporters Ghana ;
Network for Women’s Rights (Netright) ;
Centre for Women in Development and Public Policy (CEWODEPP), Ghana ;
Women in Law and Development in Africa (WiLDAF) ;
La délégation a également rencontré l'équipe pays des Nations Unies, notamment le FNUAP, représentant le Coordonnateur résident des Nations Unies, le Représentant pays du FNUAP, le Représentant pays de l'UNICEF, le Directeur pays de l'ONUSIDA, le PNUD, le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique, l'UNIC, l'UNESCO et le Pacte mondial des Nations Unies. Parmi les autres participants figuraient le Haut-Commissariat du Royaume-Uni, l'Ambassade de France et l'Ambassade des Pays-Bas.
La mission a également effectué des visites de terrain à la prison pour hommes de Nsawam (établissement à sécurité moyenne) et à la prison pour femmes de Nsawam, afin d’évaluer les conditions de détention, ainsi qu’au centre d’accueil des enfants maltraités, dans le but d’examiner les mécanismes de protection mis en place pour les enfants vulnérables.
La délégation salue la volonté politique manifeste et l’engagement du Gouvernement du Ghana en faveur de la jouissance effective des droits de l’homme, notamment à travers l’adoption, depuis la dernière mission de promotion de la Commission, de mesures législatives et autres visant à mettre en œuvre la Charte africaine ainsi que les instruments régionaux et internationaux de droits humains ratifiés.
En attendant l’adoption d’un rapport exhaustif, la Commission souhaite porter à l’attention du public les observations préliminaires suivantes.
Observations positives
La délégation félicite le Gouvernement du Ghana pour sa volonté politique affirmée et reconnaît les avancées significatives et concrètes réalisées dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme.
i. Un socle législatif et politique progressiste et solide : La République du Ghana s’est dotée d’un cadre juridique national exhaustif qui, dans de nombreux domaines, dépasse les standards régionaux. Ce socle comprend notamment la Loi sur les violences domestiques, la Loi sur le droit à l’information (2019), et la Loi sur l’action affirmative en matière d’égalité de genre. À cela s’ajoutent des instruments novateurs tels que la Loi sur la santé mentale (2012) et la Loi sur le handicap (2007), qui font figure de modèles sur le continent. Cet engagement est renforcé par l’élaboration en cours de textes législatifs progressistes, à l’instar du projet de loi sur les peines communautaires, visant à offrir des alternatives à l’incarcération et à répondre directement au problème de la surpopulation carcérale.
ii. Des réformes pragmatiques et efficaces du secteur judiciaire : La délégation a constaté des résultats tangibles grâce aux réformes visant à améliorer l'efficacité judiciaire et à garantir les droits des accusés. L'effet combiné de la loi 1079 sur la négociation de peine et de l'arrêt historique de la Cour suprême de 2015 autorisant la libération sous caution pour toutes les infractions a considérablement réduit la détention provisoire. Des initiatives opérationnelles telles que les tribunaux itinérants « Justice pour tous » sont louables pour résorber l'arriéré judiciaire directement au sein des établissements pénitentiaires. Par ailleurs, l'amnistie présidentielle, qui a conduit à la libération de 787 primo-délinquants et à la commutation des peines des condamnés à mort, témoigne d'une volonté concrète de décongestionner les prisons et de se conformer aux normes relatives aux droits humains.
iii. Des initiatives proactives et modernisatrices dans le secteur de la sécurité : Le Gouvernement a entrepris des mesures significatives pour moderniser les forces de l’ordre et renforcer leur responsabilité. Cela inclut le projet concret de mise en place d’un Comité indépendant de traitement des plaintes contre la police d’ici janvier 2026, étape cruciale pour le renforcement de la supervision. L’investissement dans un centre national de commandement de la police pour la surveillance en temps réel, ainsi que la création d’unités spécialisées en cybercriminalité, violences domestiques et renseignement criminel, traduisent une approche prospective face aux défis sécuritaires contemporains.
iv. Des programmes exemplaires de réhabilitation et de protection sociale : Le Gouvernement a mis en œuvre un ensemble de programmes sociaux ayant un impact direct sur les droits économiques et sociaux. Parmi ceux-ci figurent l’extension du programme de transferts monétaires LEAP, la gratuité de l’enseignement secondaire, le régime national d’assurance maladie (NHIS), et la récente initiative « Mahama Care » pour l’accès aux médicaments essentiels. Cet engagement en faveur de l’inclusion se reflète également dans le système pénitentiaire. La délégation a visité un établissement modèle (la prison de Nsawam) offrant un programme de réhabilitation complet : de l’éducation de base jusqu’aux diplômes universitaires, en passant par la formation professionnelle, l’alphabétisation numérique et des soins médicaux intégralement couverts par le NHIS pour tous les détenus. Des initiatives telles que l’augmentation de l’allocation alimentaire quotidienne et le lancement de projets agricoles illustrent des efforts concrets et louables pour préserver la dignité humaine.
v. Des mécanismes institutionnels dédiés et une coopération renforcée : La création de tribunaux spécialisés pour les violences domestiques, l’instauration d’une ligne téléphonique gratuite pour les violences basées sur le genre, ainsi que les efforts continus en faveur des groupes vulnérables traduisent une approche structurée face aux enjeux sociaux complexes. Le rôle proactif de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative mérite d’être salué. La politique du Ministère de l’Intérieur « pas de promotion sans formation » et la nomination d’un conseiller technique chargé de la formation continue des agents constituent des piliers institutionnels essentiels pour garantir le respect des droits humains.
vi. Un engagement renouvelé envers les mécanismes régionaux : La délégation se félicite des engagements fermes et de haut niveau pris par le Ministère des Affaires étrangères et le Département du Procureur Général pour accélérer la soumission de tous les rapports étatiques en retard à la Commission d’ici la fin de l’année 2025. La mise en place d’un comité interministériel dédié à la rédaction des rapports constitue une avancée institutionnelle positive vers le respect de cette obligation.
Principaux défis identifiés
Malgré ces avancées notables, la délégation a relevé des défis profonds et systémiques entravant la pleine réalisation des droits de l’homme dans le pays :
i. Une crise de responsabilité et de solidarité régionale : L’engagement du Ghana envers le système africain des droits de l’homme demeure gravement insuffisant, comme en témoigne un retard de 24 ans dans la soumission des rapports étatiques conformément à l’article 62 de la Charte africaine. Ce déficit est aggravé par la non-ratification de plusieurs instruments clés, notamment :
La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique;
Le Protocole relatif aux droits des personnes âgées en Afrique ;
Le Protocole relatif aux droits des personnes handicapées ;
Le Protocole relatif au droit à la protection sociale et à la sécurité sociale ;
Le Protocole relatif aux aspects spécifiques du droit à une nationalité et à l’éradication de l’apatridie ;
La Convention de l’Union africaine sur l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles.
ii. Carences systémiques dans le système judiciaire et carcéral : Malgré les réformes en cours, des défis profonds subsistent. La surpopulation carcérale a atteint un seuil critique, avec des établissements tels que la prison de sécurité moyenne de Nsawam fonctionnant à plus de 360 % de leur capacité prévue (3 496 détenus pour une capacité de 1 000). Le retard dans l’adoption du projet de loi sur les peines communautaires aggrave cette crise en ne proposant pas d’alternatives judiciaires à l’incarcération pour les infractions mineures. Par ailleurs, une disparité marquée existe entre les établissements : alors qu’une prison modèle dispense un enseignement supérieur, d’autres ne disposent même pas de programmes éducatifs de base. Des lacunes préoccupantes subsistent dans la formation des enseignants civils intervenant en milieu carcéral, et l’application inégale des normes internationales telles que les Règles Nelson Mandela demeure une source d’inquiétude.
iii. Insuffisance de la responsabilité et de la supervision policières : Malgré les projets de création d’un Comité indépendant de traitement des plaintes, les mécanismes actuels de gestion des abus policiers restent inadéquats. Des allégations de brutalité, notamment un cas cité de 2019 où sept hommes ont été faussement accusés et tués en tant que présumés braqueurs, soulignent l’urgence d’un dispositif de supervision robuste, transparent et indépendant. Le Bureau des normes de la police semble insuffisant pour répondre pleinement à ces problématiques systémiques, ce qui engendre un déficit de confiance et de responsabilité publique.
iv. La crise du Galamsey : La crise environnementale et sanitaire provoquée par l’exploitation minière illégale (Galamsey) a atteint un niveau menaçant la stabilité nationale. Il ne s’agit pas uniquement d’un problème écologique, mais d’une urgence complexe en matière de droits humains. Cette crise se manifeste par:
• La contamination généralisée des cours d’eau par des métaux lourds tels que le mercure ;
• La destruction des terres agricoles, notamment les plantations de cacao, pilier de l’économie nationale, compromettant la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance ;
• Une hausse alarmante du taux d’abandon scolaire dans les communautés touchées, les enfants étant attirés par les activités minières, mettant en péril l’avenir d’une génération ;
• L’enracinement du phénomène, alimenté par la complicité présumée d’acteurs politiques et la compromission des forces de sécurité chargées de le combattre ;
• La prolifération de la traite des enfants et de l’exploitation sexuelle dans les zones de galamsey ;
• L’exposition des femmes vivant à proximité de ces zones à des environnements dangereux, affectant leur santé sexuelle et reproductive ;
• La santé et le bien-être des enfants vivant dans ces zones sont également gravement compromis.
v. Déficit de mise en œuvre des droits et de la sécurité des femmes : Un fossé préoccupant subsiste entre les lois progressistes et la réalité vécue par les femmes et les filles. Des pratiques néfastes, telles que les accusations violentes de sorcellerie et le système Trokosi, perdurent en toute impunité. L’absence critique de refuges opérationnels financés par l’État pour les survivantes de violences basées sur le genre les laisse sans protection, situation aggravée par le financement insuffisant du Fonds contre les violences domestiques. Une stigmatisation profondément ancrée, illustrée par le refus de 8 Ghanéens sur 10 d’acheter de la nourriture à une personne vivant avec le VIH, affecte de manière disproportionnée les femmes. La situation des jeunes femmes et filles vulnérables originaires du Nord du Ghana, connues sous le nom de « Kayayei », constitue un phénomène social critique encore non pris en charge. Ces jeunes femmes sont exposées à l’exploitation, aux abus et à la traite, la plupart étant sans abri, ce qui accentue leur vulnérabilité. Malgré une réduction apparente des mutilations génitales féminines (MGF), la pratique demeure dans certaines zones du Nord, notamment sous forme transfrontalière, et continue sans relâche.
vi. Marginalisation des groupes vulnérables : Les personnes en situation de handicap font face à une exclusion significative et sont décrites comme le groupe « le plus stigmatisé et discriminé ». Les dispositifs de soutien sont insuffisants pour répondre aux besoins en matière de santé sexuelle et reproductive, comme en témoigne l’accumulation de 1 300 nouveaux cas de fistule obstétricale par jour, dont seulement 60 à 100 sont traités annuellement.
vii. Rétrécissement de l’espace civique : L’espace civique est sous pression, avec des préoccupations concernant la réaction des forces de sécurité face à la liberté d’expression et aux manifestations publiques. Bien que la Loi sur l’ordre public fournisse un cadre juridique, son application dans le contexte de protestations organisées via les réseaux sociaux soulève des interrogations sur l’équilibre entre le maintien de l’ordre public et le droit de réunion.
viii. Lacunes législatives et institutionnelles dans la prévention de la torture
L’absence de législation autonome criminalisant la torture conformément aux normes internationales constitue une lacune juridique majeure. Ce vide est aggravé par l’absence d’un Mécanisme national de prévention (MNP) indépendant, habilité à effectuer des visites inopinées dans tous les lieux de détention, et ce malgré la ratification par le Ghana du Protocole facultatif à la Convention contre la torture (OPCAT). Le système actuel repose sur une supervision interne, insuffisante pour prévenir et remédier de manière exhaustive aux abus.
Recommandations préliminaires
La Commission élaborera un rapport détaillé de mission comportant des recommandations spécifiques. Dans l’intervalle, la délégation invite instamment le Gouvernement de la République du Ghana à :
i. Honorer ses engagements régionaux et combler les lacunes en matière de protection :
Respecter l’engagement pris de soumettre l’ensemble des rapports étatiques en retard d’ici la fin de l’année 2025, dans le cadre d’un processus participatif incluant la société civile ;
Accorder une priorité à la ratification immédiate de tous les instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme encore en attente ;
ii. Renforcer les réformes dans les secteurs de la justice, de la détention et de la sécurité :
Accélérer l’adoption et la mise en œuvre du projet de loi sur les peines communautaires, en vue d’offrir des alternatives judiciaires à l’incarcération et de lutter efficacement contre la surpopulation carcérale ;
Promulguer une législation spécifique incriminant la torture et désigner formellement la CHRAJ comme Mécanisme national de prévention, habilité à effectuer des visites inopinées dans tous les lieux de détention ;
Mettre en œuvre, comme promis, le Comité indépendant de traitement des plaintes contre la police d’ici janvier 2025, en veillant à ce qu’il soit doté de ressources suffisantes, transparent et apte à sanctionner les abus et les recours excessifs à la force ;
Instituer une formation continue et standardisée en matière de droits humains pour tous les agents pénitentiaires et policiers, incluant un programme spécifique sur les Règles Nelson Mandela, les techniques de désescalade et la gestion appropriée des rassemblements publics conformément à la Loi sur l’ordre public.
iii. Traduire les lois sur le genre en résultats concrets et en garanties de sécurité :
Allouer et débloquer les fonds destinés au Fonds contre les violences domestiques, ainsi que les ressources étatiques nécessaires à la construction, à l’entretien et au soutien des refuges pour les survivantes de violences basées sur le genre et les femmes sortant de détention ;
Veiller à la mise en œuvre intégrale et à l’application effective de la Loi sur l’action affirmative (égalité de genre), afin de renforcer la participation des femmes à la vie politique et publique.
iv. Éradiquer la servitude rituelle et les pratiques néfastes :
Lancer une initiative dédiée de justice et d’application de la loi visant à éradiquer le système Trokosi, en le considérant comme une forme contemporaine d’esclavage et de traite. Cette initiative devrait inclure l’enquête et la poursuite des auteurs, ainsi que la libération, la réhabilitation et la réintégration sociale complète des femmes et filles soumises à la servitude rituelle ;
Intégrer la lutte contre le Trokosi dans une approche plus large, environnementale et économique, en reconnaissant que la pauvreté et la précarité exacerbées par des crises telles que le Galamsey créent des conditions propices à ces pratiques d’exploitation ;
Mener une étude approfondie sur la situation des « Kayayei » afin d’en identifier les causes profondes et de mettre en place des mesures pour enrayer ce phénomène ;
Lancer une campagne nationale vigoureuse pour combattre les pratiques néfastes profondément enracinées, telles que les accusations de sorcellerie, le mariage d’enfants et les mutilations génitales féminines (MGF), et pour lutter contre la stigmatisation sévère dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH.
v. Répondre aux impacts multisectoriels du Galamsey :
Il est nécessaire d’apporter une réponse multidimensionnelle impliquant un groupe de travail interministériel de haut niveau avec la pleine participation et la supervision de la Commission des droits de l’homme.
Lancer une enquête indépendante de haut niveau, assortie de garanties contre la corruption, pour démanteler les réseaux politiques et sécuritaires enracinés qui tirent profit du Galamsey ;
Répondre aux impacts transversaux dévastateurs par les mesures suivantes :
• Santé publique : Réaliser des évaluations indépendantes de l’impact sanitaire dans les communautés affectées et fournir une assistance immédiate pour les pathologies liées à l’intoxication aux métaux lourds ;
• Éducation et protection de l’enfance : Mettre en œuvre un programme majeur de bourses et de réhabilitation scolaire dans les zones minières afin de lutter contre le taux élevé d’abandon scolaire et de protéger les enfants contre le travail exploitatif ;
• Agriculture et moyens de subsistance : Créer un fonds d’urgence pour les producteurs de cacao et un programme national de réhabilitation des terres et des cours d’eau ;
• Développer des alternatives économiques viables par la formation professionnelle et la formalisation d’une exploitation minière artisanale responsable, ciblant explicitement les jeunes et les Kayayei afin de leur offrir des moyens de subsistance durables.
vi. Garantir l’inclusion, la dignité et un espace civique ouvert:
Appliquer systématiquement les lois sur l’accessibilité pour les personnes handicapées, en prévoyant des sanctions en cas de non-conformité ;
Élaborer et financer une stratégie nationale pour résorber le retard critique dans le traitement des cas de fistule obstétricale et offrir un soutien global aux enfants en situation de handicap ;
Concevoir et mettre en œuvre un Plan d’action national pour répondre au phénomène des Kayayei, en mettant l’accent sur la création d’opportunités économiques dans les régions du Nord et sur des programmes de soutien et de sortie pour celles déjà engagées dans ce cycle ;
Garantir les droits à la liberté de réunion et d’expression. Veiller à ce que le maintien de l’ordre lors des manifestations, y compris celles organisées via les réseaux sociaux, soit proportionné et que toute législation soit conforme aux obligations internationales du Ghana en matière de non-discrimination.
La délégation tient à exprimer sa profonde gratitude au Gouvernement de la République du Ghana et à son peuple pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité dont elle a bénéficié, ainsi que pour la qualité du dialogue franc et constructif entretenu tout au long de la mission. Elle remercie tout particulièrement le Ministère des Affaires étrangères pour les excellentes dispositions prises, qui ont permis à la délégation de rencontrer un large éventail d’acteurs et d’avoir une vision représentative de la situation des droits de l’homme dans le pays.
Un rapport de mission sera élaboré et soumis à la Commission pour examen et adoption lors de l’une de ses prochaines sessions, avant sa transmission officielle au Gouvernement du Ghana.
Fait à Accra, République du Ghana, le 2 octobre 2025.